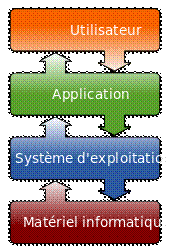Introduction à l’Informatique
Informatique
L'informatique est un domaine d'activité scientifique,
technique
et industriel
concernant le traitement automatique de
l'information via l’exécution de programmes informatiques par des machines :
des systèmes embarqués, des ordinateurs,
des robots, des automates, etc.
Définitions
Le terme « informatique » résulte de l'association des trois premières syllabes du terme « information » et des deux dernières syllabes du terme « automatique » ; il désigne à l'origine l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des ordinateurs pour traiter des informations. Dans le vocabulaire universitaire américain, il désigne surtout l'informatique théorique : un ensemble de sciences formelles qui ont pour objet d'étude la notion d'information et des procédés de traitement automatique de celle-ci, l'algorithmique. Par extension, la mise en application de méthodes informatiques peut concerner des problématiques annexes telles que le traitement du signal, la calculabilité ou la théorie de l'information.
Par ses applications, la mise en pratique de méthodes issues de l'informatique
a donné naissance, dans les années 1950, au secteur d'activité des technologies de
l'information et de la communication. Ce secteur industriel et commercial
est lié à la fois aux procédés (logiciel, architectures de systèmes) et au matériel (électronique,
télécommunication). Le secteur fournit également
de nombreux services liés à l'utilisation de ses
produits : développement, maintenance,
enseignement,
assistance, surveillance et entretien.
Étymologie
En mars 1962, le terme « Informatique » est utilisé pour la première fois, en France, par Philippe Dreyfus, ancien directeur du Centre national de calcul électronique de Bull, pour son entreprise Société d'Informatique Appliquée (SIA). Ce néologisme est formé par la combinaison du terme « information », réduit à « infor », et du terme « automatique », réduit à « matique ».
Le même mois, Walter Bauer inaugure la société américaine Informatics Inc., qui dépose son nom et poursuit toutes les universités qui utilisent ce mot pour décrire la nouvelle discipline, les forçant à se rabattre sur computer science, bien que les diplômés qu'elles forment soient pour la plupart des praticiens de l'informatique plutôt que des scientifiques au sens propre.
En 1966, en France, l'usage officiel du mot est consacré par l'Académie française pour désigner la « science du traitement de l'information », et largement adopté dès cette époque dans la presse, l'industrie et le milieu universitaire.
En juillet 1968, le ministre fédéral de la Recherche scientifique d'Allemagne, Gerhard Stoltenberg, prononce le mot « Informatik » lors d'un discours officiel sur la nécessité d'enseigner cette nouvelle discipline dans les universités de son pays ; on emploie ce même terme pour nommer certains cours dans les universités allemandes. Le mot informatica fait alors son apparition en Italie et en Espagne, de même qu’informatics au Royaume-Uni.
Le mot « informatique » est ensuite repris par la Compagnie Générale d'Informatique (CGI), créée en 1969
Évolution sémantique
Dans l'usage contemporain, le substantif « informatique » devient un mot polysémique qui désigne autant le domaine industriel en rapport avec l'ordinateur (au sens de calculateur fonctionnant avec des algorithmes), que la science du traitement des informations par des algorithmes.
Les expressions « science informatique », « informatique fondamentale » ou « informatique théorique » sont utilisées pour désigner sans ambiguïté la science, tandis que « technologies de l'information » ou « technologies de l'information et de la communication » désignent le secteur industriel et ses produits.
Histoire
Depuis des millénaires, l'Homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer (abaque, boulier…). Pour réaliser des calculs complexes, il a également mis au point des algorithmes. Parmi les algorithmes les plus anciens, on compte des tables datant de l'époque d'Hammourabi (environ -1750).
Si les machines à calculer évoluent constamment depuis l'Antiquité, elles ne permettent pas de traiter un algorithme : c'est l'homme qui doit exécuter les séquences de l'algorithme, au besoin en s'aidant de machines de calculs (comme pour réaliser les différentes étapes d'une division euclidienne). En 1642, Blaise Pascal imagine une machine à calculer, la Pascaline, qui fut commercialisée et dont sept exemplaires existent dans des musées comme celui des arts et métiers15 et dont deux sont dans des collections privées (IBM en possède une)16. Mais il faudra attendre la définition du concept de programmation (illustrée en premier par Joseph Marie Jacquard avec ses métiers à tisser à cartes perforées, suivi de Boole et Ada Lovelace pour ce qui est d'une théorie de la programmation des opérations mathématiques) pour disposer d'une base permettant d'enchaîner des opérations élémentaires de manière automatique.
Mécanographie
Une autre phase importante fut celle de la mécanographie. Dans les années 1880, Herman Hollerith, futur fondateur d'IBM, invente une machine électromécanique destinée à faciliter le recensement en stockant les informations sur une carte perforée. Les trieuses et les tabulatrices furent utilisées à grande échelle pour la première fois par les Américains lors du recensement de 1890 aux États-Unis, à la suite de l'afflux des immigrants dans ce pays dans la seconde moitié du XIXe siècle.
La première entreprise européenne qui a développé et commercialisé des équipements mécanographiques a été créée par l'ingénieur norvégien Fredrik Rosing Bull dans les années 1930 qui s'est installé en Suisse, avant de venir en France pour s'attaquer au marché français des équipements mécanographiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, René Carmille utilisait des machines mécanographiques Bull.
Les Allemands étaient équipés de machines mécanographiques déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Ces équipements étaient installés par ateliers composés de trieuses, interclasseuses, perforatrices, tabulatrices et calculatrices connectées à des perforateurs de cartes. Les traitements étaient exécutés à partir de techniques électromécaniques utilisant aussi des lampes radio comme les triodes. La chaleur dégagée par ces lampes attirait les insectes, et les bugs (terme anglais pour insectes, francisé en « bogue ») étaient une cause de panne courante. Ce n'est qu'à la suite de l'invention du transistor en 1947 et son industrialisation dans les années 1960, que l'informatique moderne a pu émerger.
Naissance de l'informatique moderne
L'informatique moderne commence avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le mathématicien Alan Turing pose les bases d'une théorisation de ce qu'est un ordinateur, avec son concept de machine universelle de Turing. Turing pose dans son article les fondements théoriques de ce qui sépare la machine à calculer de l'ordinateur : la capacité de ce dernier à réaliser un calcul en utilisant un algorithme.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'invention du transistor, puis du circuit intégré permettront de remplacer les relais électromécaniques et les tubes à vide qui équipent les machines à calculs pour les rendre à la fois plus petites, plus complexes, plus économiques et plus fiables. Des dizaines de sociétés électroniques émergent financées par le capital-risque.
Avec l'architecture de von Neumann, mise en application de la machine universelle de Turing, les ordinateurs dépassent la simple faculté de calculer et peuvent commencer à accepter des programmes plus évolués, de nature algorithmique.
Dans les années 1970, l'informatique a entamé un flirt avec les télécommunications, avec Arpanet, le réseau Cyclades et la Distributed System Architecture de réseau en couches, qui donnera naissance en 1978 au modèle OSI, appelé aussi "OSI-DSA", puis aux protocoles TCP-IP dans les années 1990, grâce à la baisse des prix des microprocesseurs. Les concepts de datagramme et d'informatique distribuée, d'abord jugés risqués, s'imposeront en fait grâce à l'Internet.
Développement des applications informatiques
La série de livres The Art of Computer Programming de Donald Knuth, publiée à partir des années 1960, fait ressortir les aspects mathématiques de la programmation informatique . Edsger Dijkstra, Niklaus Wirth et Christopher Strachey travaillent et publient dans le même sens. Ces travaux préfigurent d'importants développements en matière de langage de programmation.
L'amélioration de l'expressivité des langages de programmation a permis la mise en œuvre d'algorithmes toujours plus sophistiqués, appliqués à des données de plus en plus variées. La miniaturisation des composants et la réduction des coûts de production, associées à une augmentation de la demande en traitements des informations de toutes sortes (scientifiques, financières, commerciales, etc.), ont eu pour conséquence une diffusion de l'informatique dans toutes les couches de l'économie ainsi que dans la vie quotidienne des individus.
Des études en psychologie cognitive et en ergonomie réalisées dans les années 1970 par Xerox ont amené les outils informatiques à être équipés d'interfaces graphiques en vue de simplifier leur utilisation. Une informatique plus décentralisée est promue par les constructeurs souhaitant concurrencer le géant IBM.
La démocratisation de l'utilisation d'Internet – réseau basé sur ARPANET – depuis 1995, a amené les outils informatiques à être de plus en plus utilisés dans une logique de réseau comme moyen de télécommunication, à la place des outils tels que la poste ou le téléphone. Elle s'est poursuivie avec l'apparition des logiciels libres puis des réseaux sociaux et des outils de travail collaboratif (dont Wikipédia n'est qu'un des nombreux exemples). Face à la demande pour numériser photos, musique, les capacités de stockage, de traitement et de partage des données explosent et les sociétés qui ont parié sur la croissance la plus forte l'emportent le plus souvent, en profitant d'une énorme bulle spéculative sur les sociétés d'informatique.
Science informatique
La science informatique est une science formelle, dont l'objet d'étude est le calcul au sens large, c'est-à-dire non pas exclusivement arithmétique, mais en rapport avec tout type d'information que l'on peut représenter de manière symbolique par une suite de nombres. Ainsi, par exemple, textes, séquences d'ADN, images, sons ou formules logiques peuvent faire l'objet de calculs. Selon le contexte, on parle d'un calcul, d'un algorithme, d'un programme, d'une procédure, etc.
Calculabilité
Un algorithme est une manière systématique de procéder pour arriver à calculer un résultat. Un des exemples classiques est l'algorithme d'Euclide du calcul du « Plus grand commun diviseur » (PGCD) qui remonte au moins à 300 ans av. J.-C., mais il s'agit déjà d'un calcul complexe. Avant cela, le simple fait d'utiliser un abaque demande d'avoir réfléchi à un moyen systématique (et correct) d'utiliser cet outil pour réaliser des opérations arithmétiques.
Des algorithmes existent donc depuis l'Antiquité, mais ce n'est que depuis les années 1930, avec les débuts de la théorie de la calculabilité, que les scientifiques se sont posé les questions « qu'est-ce qu'un modèle de calcul ? » et « est-ce que tout est calculable ? » et ont tenté d'y répondre formellement.
Il existe de nombreux modèles de calcul, mais les deux principaux sont la « machine de Turing » et le « lambda calcul ». Ces deux systèmes formels définissent des objets qui peuvent représenter ce qu'on appelle des procédures de calcul, des algorithmes ou des programmes. Ils définissent ensuite un moyen systématique d'appliquer ces procédures, c'est-à-dire de calculer.
Algorithmique
L'algorithmique est l'étude comparative des différents algorithmes. Tous les algorithmes ne se valent pas : le nombre d'opérations nécessaires pour arriver à un même résultat diffère d'un algorithme à l'autre. Ce nombre d'opérations, appelé la complexité algorithmique est le sujet de la théorie de la complexité des algorithmes, qui constitue une préoccupation essentielle en algorithmique.
La complexité algorithmique sert en particulier à déterminer comment le nombre d'opérations nécessaires évolue en fonction du nombre d'éléments à traiter (la taille des données) :
- soit l'évolution peut être indépendante de la taille des données, on parle alors de complexité constante ;
- soit le nombre d'opérations peut augmenter selon un rapport logarithmique, linéaire, polynomial ou exponentiel (dans l'ordre décroissant d'efficacité et pour ne citer que les plus répandues) ;
- une augmentation exponentielle de la complexité aboutit très rapidement à des durées de calcul déraisonnables pour une utilisation en pratique,
- tandis que pour une complexité polynomiale (ou meilleure), le résultat sera obtenu après une durée de calcul réduite, même avec de grandes quantités de données.
Nous arrivons maintenant à un problème ouvert fondamental en informatique : « P est-il égal à NP ? ». En simplifiant beaucoup : P est « l'ensemble des problèmes pour lesquels on connaît un algorithme efficace » et NP « l'ensemble des problèmes pour lesquels on connaît un algorithme efficace pour vérifier une solution à ce problème ». Et en simplifiant encore plus : existe-t-il des problèmes difficiles ? Des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme efficace ?
Cette question est non seulement d'un grand intérêt théorique mais aussi pratique. En effet un grand nombre de problèmes courants et utiles sont des problèmes que l'on ne sait pas résoudre de manière efficace. C'est d'ailleurs un des problèmes du prix du millénaire et le Clay Mathematics Institute s'est engagé à verser un million de dollars aux personnes qui en trouveraient la solution.
C'est un problème ouvert, donc formellement il n'y a pas de réponse reconnue. Mais, en pratique, la plupart des spécialistes s'accordent pour penser que P≠NP, c'est-à-dire qu'il existe effectivement des problèmes difficiles qui n'admettent pas d'algorithme efficace.
Cryptologie
.
Ce type de problème de complexité algorithmique est directement utilisé en cryptologie. En effet les méthodes de cryptologie modernes reposent sur l'existence d'une fonction facile à calculer qui possède une fonction réciproque difficile à calculer. C'est ce qui permet de chiffrer un message qui sera difficile à décrypter (sans la clé).
La plupart des chiffrements (méthode de cryptographie) reposent sur le fait que la procédure de Décomposition en produit de facteurs premiers n'a pas d'algorithme efficace connu. Si quelqu'un trouvait un tel algorithme il serait capable de décrypter la plupart des cryptogrammes facilement. On sait d'ailleurs qu'un calculateur quantique en serait capable, mais ce genre d'ordinateur n'existe pas, en tout cas pour le moment.
Technologies de l'information et de la communication
Le terme technologies de l'information et de la communication désigne un secteur d'activité et un ensemble de biens qui sont des applications pratiques des connaissances scientifiques en informatique ainsi qu'en électronique numérique, en télécommunication, en sciences de l'information et de la communication et en cryptologie.
- Le matériel informatique est un ensemble d'équipements (pièces détachées) servant au traitement des informations.
- Un logiciel contient des suites d'instructions qui décrivent en détail les algorithmes des opérations de traitement d'information ainsi que les informations relatives à ce traitement (valeurs clés, textes, images, etc.).
Le système de numération binaire est utilisé aujourd'hui dans tous les appareils en électronique numérique pour représenter l'information sous une forme qui peut être manipulée par des composants électroniques.
Les appareils informatiques sont équipés de quatre unités qui servent respectivement à entrer des informations, les stocker, les traiter puis les faire ressortir de l'appareil, selon les principes de la machine de Turing et l'architecture de von Neumann. Les informations circulent entre les pièces des différentes unités par des lignes de communication – les bus. Le processeur est la pièce centrale qui anime l'appareil en suivant les instructions des programmes qui sont enregistrés à l'intérieur.
Appareils informatiques
Logiciel d'ordinateur dans un distributeur de billets.
Il existe aujourd'hui une gamme étendue d'appareils capables de traiter automatiquement des informations. De ces appareils, l'ordinateur est le plus connu, le plus ouvert, le plus complexe et un des plus anciens. L'ordinateur est une machine modulable et universelle qui peut être adaptée à de nombreuses tâches par ajout de matériel et/ou de logiciel.
Un système embarqué est un appareil équipé de matériel et de logiciel informatique, et assigné à une tâche bien précise.
Matériel informatique
Le matériel informatique (« hardware » en anglais) est l'ensemble des pièces « électroniques » nécessaires au fonctionnement des appareils informatiques. Les appareils comportent généralement un boîtier dans lequel se trouvent les pièces centrales (par exemple le processeur), et des pièces périphériques servant à l'acquisition, au stockage, à la restitution et la transmission d'informations. L'appareil est un assemblage de pièces qui peuvent être de différentes marques. Le respect des normes industrielles par les différents fabricants assure le fonctionnement de l'ensemble.
Carte mère
La carte mère est un circuit imprimé constituant le support principal des éléments essentiels d'un ordinateur etc.
Boîtier et périphériques
L'intérieur du boîtier d'un appareil informatique contient un ou plusieurs circuits imprimés sur lesquels sont soudés des composants électroniques et des connecteurs. La carte mère est le circuit imprimé central, sur lequel sont connectés tous les autres équipements.
Un bus est un ensemble de lignes de communication qui servent aux échanges d'information entre les composants de l'appareil informatique. Les informations sont transmises sous forme de suites de signaux électriques. Le plus petit élément d'information manipulable en informatique correspond à un bit. Les bus transfèrent des bytes d’informations composés de plusieurs bits en parallèle.
Les périphériques sont par définition les équipements situés à l'extérieur du boîtier.
Équipements d'entrée
Le boîtier avec la carte mère, le ventilateur du processeur, l'alimentation et la mémoire.
Carte interchangeable, circuit imprimé assurant support et liaison pour les composants numériques.
Les périphériques d'entrée servent à commander l'appareil informatique ou à y envoyer des informations.
L'envoi des informations se fait par le procédé de numérisation. La numérisation est le procédé de transformation d'informations brutes (une page d'un livre, les listes des éléments périodiques…) en suites de nombres binaires pouvant être manipulées par un appareil informatique. La transformation est faite par un circuit électronique. La construction du circuit diffère en fonction de la nature de l'information à numériser.
L'ensemble des dispositifs de commande et les périphériques de sortie directement associés forment une façade de commande appelée interface homme-machine.
Stockage d'information
Une mémoire est un dispositif électronique (circuit intégré) ou électromécanique destiné à conserver des informations dans un appareil informatique.
- Une mémoire de masse est un dispositif de stockage de grande capacité, souvent électromagnétique (bandes magnétiques, disques durs), destiné à conserver longtemps une grande quantité d'informations.
- Un disque dur est une mémoire de masse à accès direct, de grande capacité, composée d'un ou de plusieurs disques rigides superposés et magnétiques. L'IBM Ramac 305, le premier disque dur, a été dévoilé en 1956. Le disque dur est une des mémoires de masse les plus utilisées en informatique. Pour gérer de grandes volumétries, ces disques sont associés par des mécanismes logiciels permettant d'étendre leur capacité (jusqu'à plusieurs Po) et d'y intégrer une protection avancée (RAID et Réplication au niveau bloc. Réplication, Versioning et Snapshot au niveau fichier).
- Une mémoire morte (« Read Only Memory » en anglais, ou ROM) est une mémoire composée de circuits intégrés où les informations ne peuvent pas être modifiées. Ce type de mémoire est toujours installé par le constructeur et utilisé pour conserver définitivement des logiciels embarqués.
- Une mémoire vive est une mémoire composée de circuits intégrés où les informations peuvent être modifiées. Les informations non enregistrées sont souvent perdues à la mise hors tension.
Processeur
Processeur.
Un processeur est un composant électronique qui exécute des instructions.
Un appareil informatique contient un processeur, voire deux, quatre, ou plus. Les ordinateurs géants contiennent des centaines, voire des milliers de processeurs.
L'acronyme CPU (pour l'anglais Central Processing Unit) désigne le ou les processeurs centraux de l'appareil. L'exécution des instructions par le ou les CPU influence tout le déroulement des traitements.
Un microprocesseur multi-cœur réunit plusieurs circuits intégrés de processeur dans un seul boîtier. Un composant électronique construit de cette manière effectue le même travail que plusieurs processeurs.
Équipements de sortie
Les équipements de sortie servent à présenter les informations provenant d'un appareil informatique sous une forme reconnaissable par un humain.
- Un convertisseur numérique-analogique (en anglais Digital to Analog Converter ou DAC) est un composant électronique qui transforme une information numérique (une suite de nombres généralement en binaire) en un signal électrique analogique. Il effectue le travail inverse de la numérisation, exemple un lecteur de CD audio.
- Un écran est une surface sur laquelle s'affiche une image (par exemple des fenêtres de dialogue et des documents). Les images à afficher sont générées par un circuit électronique convertisseur numérique-analogique en sortie des cartes vidéos pour l'affichage sur les écrans analogiques. De plus en plus souvent l'étape du DAC est supprimée grâce à la connexion HDMI avec les écrans interprétant directement les images numérique.
- Un moniteur est un écran utilisant les mêmes techniques que celles utilisées par les téléviseurs, qui affiche des graphiques et des textes provenant de l'appareil informatique.
- Une imprimante est un équipement servant à produire des informations non volatiles, sous forme d'impression sur papier. Il peut s'agir de textes, de tableaux, de graphiques, de schémas, de photos, etc.
- Un haut-parleur,
un « jack » ou l'on peut brancher un casque, un
système d'enceintes amplifiées, ou tout système audio, afin de reproduire
les sons dans le spectre audible par les humains,
fabriqués ou passant par la carte son,
cette dernière utilisant aussi un DAC mais aussi ADC permettant de
digitaliser les signaux analogiques provenant de microphones
ou de tout appareil
électronique de reproduction sonore que l'on connecte au connecteur mic ou line.
Transmission par câbles.
Équipements de réseau
Les équipements de réseau servent à la communication d'informations entre des appareils informatiques, en particulier à l'envoi d'informations, à la réception, à la retransmission, et au filtrage.
Les communications peuvent se faire par câble, par onde radio, par satellite, ou par fibre optique.
Un protocole de communication est une norme industrielle relative à la communication d'informations. La norme établit autant le point de vue électronique (tensions, fréquences) que le point de vue informationnel (choix des informations, format) ainsi que le déroulement des opérations de communication (qui initie la communication, comment réagit le correspondant, combien de temps dure la communication, etc.).
Selon le modèle OSI – qui comporte sept niveaux –, une norme industrielle (en particulier un protocole de communication) d'un niveau donné peut être combinée avec n'importe quelle norme industrielle d'une couche située en dessus ou en dessous.
Une carte réseau est un circuit imprimé qui sert à recevoir et envoyer des informations conformément à un ou plusieurs protocoles.
Un modem est un équipement qui sert à envoyer des informations sous forme d'un signal électrique modulé, ce qui permet de les faire passer sur une ligne de communication analogique telle une ligne téléphonique.
Logiciel informatique
Un logiciel est un ensemble d'informations relatives à un traitement automatisé qui correspond à la « procédure » d'une Machine de Turing, la mécanique de cette machine correspondant au processeur. Le logiciel peut être composé d'instructions et de données. Les instructions mettent en application les algorithmes en rapport avec le traitement d'information voulu. Les données incluses dans un logiciel sont les informations relatives à ce traitement ou exigées par lui (valeurs clés, textes, images, etc.).
Le logiciel peut prendre une forme exécutable (c'est-à-dire directement compréhensible par le micro-processeur) ou source, c'est-à-dire dont la représentation est composée d'une suite d'instructions directement compréhensible par un individu. Ainsi donc, on peut considérer le logiciel comme une abstraction qui peut prendre une multitude de formes : il peut être imprimé sur du papier, conservé sous forme d'un fichier fichiers informatiques ou encore stocké dans une mémoire (une disquette, une clé USB).
Catégories de logiciels.
Un appareil informatique peut contenir de très nombreux logiciels, organisés en trois catégories :
- logiciel applicatif : un logiciel applicatif contient les instructions et les informations relatives à une activité automatisée. Un ordinateur peut stocker une panoplie de logiciels applicatifs, correspondant aux très nombreuses activités pour lesquelles il est utilisé ;
- logiciel système : un logiciel système contient les instructions et les informations relatives à des opérations de routine effectuées par les différents logiciels applicatifs ;
- système d'exploitation : le système d'exploitation est un logiciel système qui contient l'ensemble des instructions et des informations relatives à l’utilisation commune du matériel informatique par les logiciels applicatifs ;
- micrologiciel (firmware en anglais) : lors d'une utilisation d'un équipement matériel déterminé – lors d'une opération de routine. Un micrologiciel contient les instructions et les informations relatives au déroulement de cette opération sur l'équipement en question. Un appareil informatique peut contenir de nombreux micrologiciels. Chaque micrologiciel contient les instructions et les informations relatives à tous les traitements qui peuvent être effectués par les équipements d'une série ou d'une marque déterminée.
Un logiciel embarqué, un logiciel libre, un logiciel propriétaire font référence à une manière de distribuer le logiciel. Voir « distribution de logiciels ».
Logiciel applicatif
Un logiciel applicatif ou application informatique contient les instructions et les informations relatives à une activité automatisée par un appareil informatique (informatisée). Il peut s'agir d'une activité de production (exemple : activité professionnelle), de recherche, ou de loisir.
- Par exemple, une application de gestion est un logiciel applicatif servant au stockage, au tri et au classement d'une grande quantité d'informations. Les traitements consistent en la collecte et la vérification des informations fraîchement entrées, la recherche d'informations et la rédaction automatique de documents (rapports).
Logiciel système
Un logiciel système contient les instructions et les informations relatives à des opérations de routine susceptibles d'être exécutées par plusieurs logiciels applicatifs. Un logiciel système sert à fédérer, unifier et aussi simplifier les traitements d'un logiciel applicatif. Les logiciels systèmes contiennent souvent des bibliothèques logicielles.
Lorsqu'un logiciel applicatif doit effectuer une opération de routine, celui-ci fait appel au logiciel système par un mécanisme appelé appel système. La façade formée par l'ensemble des appels systèmes auquel un logiciel système peut répondre est appelée Interface de programmation ou API (acronyme de l'anglais Application programming Interface).
Un logiciel applicatif effectue typiquement un grand nombre d'appels système, et par conséquent peut fonctionner uniquement avec un système d'exploitation dont l'interface de programmation correspond. Le logiciel est alors dit compatible avec ce système d'exploitation, et inversement.
Système d'exploitation
Le système d'exploitation est un logiciel système qui contient l'ensemble des instructions et des informations relatives à l’utilisation commune du matériel informatique par les logiciels applicatifs.
Les traitements effectués par le système d'exploitation incluent : répartition du temps d'utilisation du processeur par les différents logiciels (multitâche), répartition des informations en mémoire vive et en mémoire de masse. En mémoire de masse, les informations sont groupées sous formes d'unités logiques appelées fichiers.
Les traitements effectués par le système d'exploitation incluent également les mécanismes de protection contre l'utilisation simultanée par plusieurs logiciels applicatifs d'équipements de matériel informatique qui par nature ne peuvent pas être utilisés de manière partagée (voir Exclusion mutuelle).
POSIX est une norme industrielle d'une interface de programmation qui est appliquée dans de nombreux systèmes d'exploitation, notamment la famille UNIX.
Environnement graphique
Environnement graphique.
L’environnement graphique est le logiciel système qui organise automatiquement l'utilisation de la surface de l'écran par les différents logiciels applicatifs et redirige les informations provenant des dispositifs de pointage (souris). L'environnement graphique est souvent partie intégrante du système d'exploitation.
Système de gestion de base de données
Une base de données est un stock structuré d'informations enregistré dans un dispositif informatique.
Un système de gestion de base de données (sigle : SGBD) est un logiciel système dont les traitements consistent à l'organisation du stockage d'informations dans une ou plusieurs bases de données. Les informations sont disposées de manière à pouvoir être facilement modifiées, triées, classées, ou supprimées. Les automatismes du SGBD incluent également des protections contre l'introduction d'informations incorrectes, contradictoires ou dépassées
Micrologiciel
Puce contenant un micrologiciel.
- Dans un équipement informatique : lors d'une utilisation d'un équipement matériel déterminé - lors d'une opération de routine. Un micrologiciel contient les instructions et les informations relatives au traitement de cette opération sur l'équipement en question. Chaque micrologiciel contient les informations relatives à tous les traitements de routine qui peuvent être effectués par les équipements d'une série ou d'une marque déterminée.
- BIOS (acronyme de l'anglais Basic Input Output System) est le nom du micro-logiciel incorporé à la carte mère d'un ordinateur et est développé spécifiquement pour celle-ci. Il contient toutes les routines spécifiques : boot ou démarrage du système d'exploitation, gestion des entrées-sorties, gestion de l'énergie et du refroidissement, etc. C'est à lui que s'adresse le système d'exploitation pour effectuer une grande diversité de taches.
- Dans un appareil électronique : les micrologiciels sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques pour réaliser des automatismes difficiles à réaliser avec uniquement des circuits électroniques. Par exemple dans des appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle) ou les moteurs (calcul de la durée d'injection).
Le micrologiciel est souvent distribué sur une puce de mémoire morte faisant partie intégrante du matériel en question. Il peut être mis à jour soit en changeant la ROM ou pour les systèmes les plus récents en réécrivant la mémoire flash.
Utilisations et domaines d'activités
Le traitement de l'information s'applique à tous les domaines d'activité et ceux-ci peuvent se trouver associés au mot « informatique », comme dans « informatique médicale », où les outils informatiques sont utilisés dans l'aide au diagnostic (ce champ d'activité se rapportera plutôt à l'informatique scientifique décrite ci-dessous), ou dans « informatique bancaire », désignant des systèmes d'information bancaire qui relèvent plutôt de l'informatique de gestion, de la conception et de l'implantation de produits financiers qui relève plutôt de l'informatique scientifique et des mathématiques, ou encore de l'automatisation des salles de marché qui en partie relève de l'informatique temps réel.
Les grands domaines d'utilisation de l'informatique sont :
- Informatique de gestion : informatique en rapport avec la gestion de données, à savoir le traitement en masse de grandes quantités d'information. L'informatique de gestion a de nombreuses applications pratiques dans les entreprises : manipulation des informations relatives aux employés, commandes, ventes, statistiques commerciales, journaux de comptabilité générale y compris, en son temps, le calcul du décalage pour les déclarations de TVA à récupérer et gestion de la production et des approvisionnements, gestion de stocks et des inventaires… Ce domaine est de loin celui qui représente la plus forte activité.
- Informatique scientifique : elle consiste à aider les ingénieurs de conception dans les domaines de l'ingénierie industrielle à concevoir et dimensionner des équipements à l'aide de programmes de calcul : réacteurs nucléaires, avions, automobiles (langages souvent employés : historiquement le Fortran, de plus en plus concurrencé par C et C++). L'informatique scientifique est surtout utilisée dans les bureaux d'étude et les entreprises d'ingénierie industrielle car elle permet de simuler, par la recherche opérationnelle ou par itération, des scénarios de façon rapide et fiable. Par exemple, l'écurie italienne de Formule 1 Scuderia Ferrari s'est équipée en 2006 avec un des plus puissants calculateurs du monde afin de permettre les essais numériques de sa monoplace et accélérer la mise au point de ses prototypes ;
- Informatique embarquée : elle consiste à définir les logiciels destinés à être embarqués dans des dispositifs matériels autonomes interagissant avec leur environnement physique. L'informatique embarquée assure alors parfois le pilotage de systèmes électromécaniques plus ou moins complexes. Elle est ainsi à rapprocher de la production de systèmes informatiques temps réel tant le temps devient une préoccupation clef lorsque l'informatique est acteur du monde réel. Elle trouve aussi ses domaines d'applications dans de nombreux objets de notre vie quotidienne en enrichissant les performances et les fonctionnalités des services proposés. Historiquement d'abord liés à l'aéronautique, le spatial, l'armement, le nucléaire, on en trouve aujourd'hui de nombreuses illustrations dans notre vie quotidienne : automobile, machine à laver, téléphone portable, carte à puce, domotique, etc. ;
- Ingénierie des connaissances (en anglais « knowledge management ») : il s'agit d'une forme d'ingénierie informatique qui consiste à gérer les processus d'innovation, dans tous les domaines, selon des modèles assez différents de ceux jusqu'alors employés en informatique de gestion. Cette forme d'ingénierie permettra peut-être de mieux mettre en cohérence les trois domaines gestion, temps réel, et scientifique dans l'organisation des entreprises. Elle s'intéresse plus au contenu et à la qualité des bases de données et de connaissances qu'à l'automatisation des traitements. Elle se développe déjà beaucoup aux États-Unis ;
- il faut enfin citer les applications du renseignement économique et stratégique (« intelligence » en anglais), qui font appel aux techniques de l'information, notamment dans l'analyse du contexte, pour la recherche d'informations (moteurs de recherche). D'autre part, dans une optique de développement durable, il est nécessaire de structurer les relations avec les parties prenantes, ce qui fait appel à d'autres techniques telles les protocoles d'échange et les moteurs de règles.
Marché de l'informatique
On trouve dans le monde environ un milliard de micro-ordinateurs, trois cent mille stations de travail, quelques dizaines de milliers de mainframes, et deux mille superordinateurs en état de marche.
On ne connaît pas avec certitude la part de marché occupée par l'industrie des systèmes embarqués, mais on estime que l'informatique représente le tiers du coût d'un avion ou d'une voiture
La distribution des produits informatiques est faite sous la forme de multiples canaux de distribution, parmi lesquels on compte la vente directe, le e-commerce, les chaînes de revendeurs, les groupements de revendeurs, la vente par correspondance.
Les grossistes informatiques ont un rôle clef dans la distribution informatique et sont un point de passage quasi obligé pour les sociétés qui ont choisi la vente indirecte (par un réseau de revendeurs). Les grossistes, qu'ils soient généralistes ou spécialisés, adressent la multitude de petits points de vente ou les sociétés de service pour lesquelles l'activité de négoce représente un volume d'activité faible.
Aujourd'hui la plupart des constructeurs sont spécialisés soit dans le
matériel, soit dans le logiciel, soit dans les services.
Apple et Oracle (Sun)
sont parmi les seuls constructeurs spécialisés à la fois dans le matériel et le
logiciel. IBM et HP
sont parmi les seuls constructeurs spécialisés à la fois dans le matériel et
les services.
Histoire
Historiquement, le matériel informatique était distribué par les grands constructeurs qui traitaient en direct avec leurs clients ; la plupart de ceux-ci étant de grandes entreprises ou des organismes publics. Les logiciels étaient créés par les clients. Les constructeurs fournissaient uniquement un système d'exploitation, et assistaient leurs clients par l'organisation de cours de programmation à la formation des analystes programmeurs. Au fur et à mesure de la baisse des prix des systèmes, le marché s'est élargi, obligeant plusieurs constructeurs à se structurer pour mieux diffuser leur produit et à s'appuyer sur des partenaires.
Ces partenaires étaient au départ mono-marque et travaillaient souvent sous la forme d'agent semi-exclusif, puis ils se sont transformés au fil du temps en revendeurs indépendants multi-marques.
Dans les années 1980, en même temps que les premiers micro-ordinateurs, sont apparus les premiers éditeurs spécialisés dans le logiciel.
Depuis 1987, le marché du micro-ordinateur est le principal secteur du marché informatique, et les micro-ordinateurs, initialement utilisés à des fins domestiques, sont désormais largement utilisés dans les entreprises et les institutions, où ils tendent à remplacer les stations de travail et parfois les mainframes.
Du fait de la croissance très rapide du marché, vecteur de forte concurrence, de nombreuses sociétés ont disparu dans les années 1980. Des quatorze grands fabricants de l'époque, en 1997 il n'en reste plus que deux (Intel et AMD)
Marché du matériel
L'ordinateur est un appareil modulable, construit par assemblage de
composants de différentes marques.
Le développement et la construction des composants est le fait de quelques
marques très spécialisées. La majorité des constructeurs d'ordinateurs sont des
assembleurs : un assembleur est une société qui vend des
ordinateurs construits par assemblage de composants provenant d'autres marques,
y compris de concurrents.
Loi de Moore
Alignement à la loi de Moore.
En 1965, Gordon Earle Moore, cofondateur d'Intel, un grand fabricant de microprocesseurs, émettait la Loi de Moore. Cette loi, basée sur l'observation, prédit que la complexité des microprocesseurs devrait doubler tous les deux ans. Quarante ans plus tard, cette observation se confirme toujours. Selon le magazine Ligne de crédit, l'alignement à la Loi de Moore n'est pas le fait du hasard, mais une volonté de l'industrie informatique.
Offre en matériel
Le matériel informatique est aujourd'hui produit par diverses multinationales. Exemples :
En Autriche par exemple, les principales marques d'ordinateur sont, en 2007 : Hewlett-Packard (Palo Alto, États-Unis), Dell, (Round Rock, États-Unis), Fujitsu (Japon), Siemens (Berlin, Allemagne), Sony (Tokyo, Japon) et Acer (Taïwan)
Marché du logiciel
La fabrication d'un logiciel (développement) demande très peu de moyens techniques, et par contre beaucoup de temps et de savoir-faire.
Il existe aujourd'hui un très grand nombre d'auteurs de logiciels, il peut s'agir de multinationales comme Microsoft, de petites entreprises locales, voire de particuliers ou de bénévoles.
Les grosses entreprises, utilisant du matériel informatique pour leurs propres besoins, ont souvent des équipes spécialisées, qui créent des logiciels sur mesure pour les besoins de l'entreprise. Ces logiciels ne seront jamais mis sur le marché. Un progiciel est un logiciel prêt-à-porter et générique prévu pour répondre à un besoin ordinaire. Par opposition à un logiciel spécifique, qui est développé sur mesure en vue de répondre au besoin d'un client en particulier. La crėation de logiciels spécifique est le principal sujet de contrats de services des entreprises informatiques.
Dans des secteurs industriels comme l'aviation, des équipes créent des logiciels pour les systèmes embarqués de ce secteur. Ces logiciels ne sont jamais mis sur le marché séparément.
Un logiciel étant un ensemble d'informations, il peut être transmis par les moyens de télécommunications. Le téléchargement est l'opération qui consiste à utiliser un réseau de télécommunication pour récupérer un logiciel en provenance d'un autre appareil. Le e-commerce est l'activité qui consiste à vendre des logiciels (ou d'autres biens) en les distribuant par des réseaux de télécommunication comme Internet.
Types de logiciels
On peut distinguer quatre grands types de logiciels : libres, propriétaires, shareware, freeware, en fonction du type de contrat de licence qui régit leur distribution, utilisation et copie.
- Un logiciel libre (ou open source) est un logiciel que l'on peut utiliser, étudier, modifier et redistribuer librement. Un tel logiciel peut être soumis au droit d'auteur (sous une certaine licence) ou non (dans le domaine public). Les logiciels libres sont souvent distribués gratuitement.
- Un logiciel propriétaire peut être utilisé, mais ne peut pas être ni étudié, ni modifié, ni redistribué librement. Ces logiciels sont le plus souvent distribués par l'intermédiaire de réseaux de vente et, pour certains d'entre eux, associés de manière plus ou moins licite, à la vente d'un micro-ordinateur.
- Un gratuiciel (en anglais freeware) est un logiciel qui peut être distribué gratuitement. L'auteur se réserve le droit exclusif de le modifier.
- Un partagiciel (ou shareware) est un logiciel propriétaire qui est gratuit pendant une période d'essai et payant ensuite. De nombreuses variantes de shareware existent, selon le paiement demandé (qui est parfois un don à une organisation caritative, l'envoi d'une carte postale à l'auteur…) et le fonctionnement du logiciel à la fin de la période d'essai (le logiciel peut tomber en panne, ou alors il reste utilisable mais importune l'utilisateur en l'avertissant de façon répétée qu'il doit acheter le produit…).
- Un micrologiciel (ou firmware) est un logiciel incorporé dans un matériel informatique, et indissociable de celui-ci.
Terminologie de la distribution de logiciels
Offre générale en logiciels
Il existe aujourd'hui une offre très large de logiciels, de tous les types : libres, propriétaires, shareware et freeware.
L'industrie du logiciel est un des principaux secteurs économiques en Europe et aux États-Unis. De nombreux constructeurs de logiciels sont aux États-Unis. La création de logiciels applicatifs représente 52 % de l'activité.
Si le Japon est un des pays les mieux équipés en matériel informatique, on y trouve les plus grands fabricants de matériel, il n'en va pas de même pour le logiciel, et de nombreux logiciels posent des problèmes pour l'écriture de textes en utilisant l'alphabet japonais.
Il existe en 2008 environ quatre-vingts systèmes d'exploitation différents. Le marché est largement occupé par la famille Windows : cette famille de systèmes d'exploitation, propriété de Microsoft occupe environ 90 % du marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels. La société Microsoft a fait l'objet de divers procès pour monopolisation du marché.
Offre en logiciels libres
GNU est un projet de système d'exploitation lancé en 1985, entièrement basé sur des produits open source. Linux est un système d'exploitation open source, écrit par une équipe de plus de 3 200 bénévoles. La valeur de revente de Linux est estimée à plus de 1,4 milliard de dollars.
L'offre en logiciels libres consiste notamment en des ensembles qui contiennent à la fois des produits GNU et Linux. Ils sont distribués avec des magazines, ou mis à disposition pour le téléchargement.
Aujourd'hui la majorité des téléphones portable sont basés sur des systèmes d'exploitation libres : OS X a été développé à partir de Free BSD, Android est quant à lui basé sur un système Linux classique. Ce qui fait des système Open Source linux et free BSD les systèmes les plus répandus sur le marché du téléphone portable.
Piratage
Vendeur pirate.
Le piratage consiste à utiliser ou à mettre à
disposition tout ou partie d'un logiciel alors que sa licence ne l'autorise
pas.
La licence d'utilisation s'apparente à un contrat
(dont la valeur juridique varie selon les pays) accepté implicitement par tout
acheteur d'un logiciel (ou explicitement lors de l'installation ou du premier
lancement de celui-ci).
Par une licence propriétaire, l'éditeur octroie le droit, généralement exclusif et non transmissible, à l'acheteur d'utiliser le logiciel. Si une copie de ce logiciel est mise à disposition d'autrui, l'utilisation par autrui est alors une violation des clauses du contrat de licence et la mise à disposition est considérée comme un acte de contrefaçon.
La vente de licences d'utilisation est la première source de revenus de nombreux éditeurs logiciels et le piratage représente pour eux un important manque à gagner. Le piratage touche le marché du logiciel comme les marchés d'autres biens immatériels tels que la musique ou la vidéo.
Les éditeurs vendent souvent leur logiciel accompagné de services tels que garantie et mises à jour, des services qui ne sont, la plupart du temps, disponibles que sur les logiciels légalement utilisés.
Le nombre de copies de logiciels vendues par des pirates est plus ou moins élevé selon les pays. Selon la Business Software Alliance, en Algérie 85 % des logiciels vendus en 2008 seraient issus du piratage. Toujours selon la Business Software Alliance, au Luxembourg, ce taux aurait été de 21 % en 2007, ce qui serait le taux le plus bas du monde.
Marché des services
Le passage d'un marché industriel de produits à un marché des services est relativement récent et en forte progression. Le commerce de services consiste principalement en la vente et l'exécution de mandats concernant des modifications sur des systèmes d'information d'entreprises ou de collectivités.
Les systèmes d'information des entreprises sont parfois composés de centaines d'ordinateurs, sur lesquels sont exécutés des centaines de logiciels de manière simultanée. Il existe de nombreux liens entre les différents logiciels et les différents ordinateurs, et le simple fait d'arrêter un seul des éléments risque de déranger des milliers d'usagers, voire de provoquer le chômage technique de l'entreprise.
Selon le cabinet Gartner Dataquest, les services informatiques ont généré 672,3 milliards de dollars dans le monde en 2006. Soit un marché en augmentation de 6,4 % par rapport à 2005.
Un consultant est une personne chargée d'une mission de services.
Offre en services
- Une SSII (abréviation de Société de Service en Ingénierie Informatique) est une société qui met à disposition des spécialistes pour des missions de service sur des systèmes informatiques.
De nombreuses SSII se trouvent aux États-Unis et en Inde. Parmi les leaders du marché on trouve IBM – la plus ancienne société d'informatique encore en activité –, ainsi que EDS, Accenture et Hewlett-Packard, toutes originaires des États-Unis.
Les principaux sujets des mandats sont la création de logiciels sur mesure, la mise en place de progiciels et la modification des fichiers de configuration en fonction des besoins, des opérations de réglage, d'expertise et de surveillance du système informatique. En France la majorité des constructeurs de logiciels sont des SSII.
- SAP désigne par abus de langage un progiciel de gestion intégré pour les entreprises, construit par la société SAP AG (Walldorf, Allemagne). L'adaptation aux besoins des entreprises de ce logiciel riche et multi-fonctionnel est une activité courante des SSII.
Métiers et activités
L'informaticien est d'une manière générale une personne qui travaille dans le secteur de l'informatique. Il existe dans ce secteur diverses activités qui sont orientées vers la création de logiciels ou la maintenance d'un système informatique – matériel et logiciels.
Le secteur dépend également des activités des fabricants de semi-conducteurs et de pièces détachées, des assembleurs, ainsi que des fournisseurs de télécommunications et des services d'assistance.
Maintenance d'un système informatique
La maintenance d'un système informatique consiste à la préparation d'ordinateurs tels que serveurs, ordinateurs personnels, ainsi que la pose d'imprimantes, de routeurs ou d'autres appareils. L'activité consiste également au dépannage des machines, à l'adaptation de leur configuration, l'installation de logiciels tels que systèmes d'exploitation, systèmes de gestion de base de données ou logiciels applicatifs, ainsi que divers travaux de prévention des pannes, des pertes ou des fuites d'informations telles que l'attribution de droits d'accès ou la création régulière de copies de sauvegarde (backup en anglais).
Le directeur informatique décide des évolutions du système informatique dans les grandes lignes, conformément à la politique d'évolution de la société qui l'emploie. Il sert d'intermédiaire entre les fournisseurs et les clients (employés de l'entreprise), ainsi que la direction générale. Il propose des budgets, des évolutions, puis mandate des fournisseurs pour des travaux.
L'ingénieur système travaille à la mise en place et l'entretien du système informatique : la pose de matériel informatique, l'installation de logiciels tels que systèmes d'exploitation, systèmes de gestion de base de données ou logiciels applicatifs, et le réglage des paramètres de configuration des logiciels.
L'administrateur de bases de données est chargé de la disponibilité des informations contenues dans des bases de données et la bonne utilisation des systèmes de gestion de base de données – les logiciels qui mettent à disposition les informations et qui occupent une place stratégique dans de nombreuses entreprises. Il s'occupe des travaux de construction, d'organisation et de transformation des bases de données, ainsi que du réglage des paramètres de configuration du système de gestion de base de données et de l'attribution de droit d'accès sur le contenu des bases de données.
Le responsable d'exploitation veille à la disponibilité constante du système informatique. Il effectue des tâches de sauvegarde régulière en vue de prévenir la perte irrémédiable d'informations, organise les travaux de transformation du système informatique en vue de limiter la durée des mises hors service et attribue des droits d'accès en vue de limiter les possibilités de manipulation du système informatique au strict nécessaire pour chaque usager – ceci en vue de prévenir des pertes ou des fuites d'information.
Création de logiciels
Le développement de logiciels consiste à la création de nouveaux logiciels ainsi que la transformation et la correction de logiciels existants. En font partie la définition d'un cahier des charges pour le futur logiciel, l'écriture du logiciel dans un ou l'autre langage de programmation, le contrôle du logiciel créé, la planification et l'estimation du budget des travaux.
Dans une équipe d'ingénieurs, le chef de projet est chargé d'estimer la durée des travaux, d'établir un planning, de distribuer les tâches entre les différents membres de l'équipe, puis de veiller à l'avancée des travaux, au respect du planning et du cahier des charges. Le chef de projet participe également à la mise en place du logiciel chez le client et récolte les avis des usagers.
L'analyste-programmeur est chargé d'examiner le cahier des charges du futur logiciel, de déterminer la liste de les toutes les tâches de programmation nécessaire pour mettre en œuvre le logiciel. Il est chargé de déterminer les automatismes les mieux appropriés en fonction du cahier des charges et des possibilités existantes sur le système informatique. L'analyste-programmeur est ensuite chargé d'effectuer les modifications nécessaires dans le logiciel, de rédiger ou de modifier le code source du logiciel et de vérifier son bon fonctionnement.
L'architecte des systèmes d'informations est chargé de déterminer, d'organiser et de cartographier les grandes lignes de systèmes informatiques ou de logiciels. Il réalise des plans d'ensemble, détermine les composants (logiciel et matériel) principaux de l'ensemble, ainsi que les flux d'informations entre ces composants. Lors de la création de nouveaux logiciels il est chargé de découper le futur logiciel en composants, puis d'organiser et de cartographier le logiciel et les produits connexes.
Sous-traitance, infogérance, intégration
Les entreprises et les institutions qui ont un système informatique de grande ampleur ont souvent une équipe d'informaticiens qui travaillent à la maintenance du système ainsi qu'à la création de logiciels pour le compte de l'entreprise. Cette équipe, dirigée par le directeur informatique peut faire appel à des éditeurs de logiciel ou des sociétés de services en ingénierie informatique (abréviation SSII) pour certains travaux. Par exemple, lorsque l'équipe interne est trop peu nombreuse ou ne possède pas les connaissances nécessaires. Les entreprises peuvent également faire appel à des consultants – des employés d'une société tierce – pour prêter main forte ou conseiller leur équipe sur un sujet précis.
L'infogérance consiste à déléguer toute la maintenance du système d'information à une société de services. Ces services sont parfois réalisés offshore : des équipes délocalisées (parfois situées dans un pays lointain) pilotent les ordinateurs à travers les réseaux informatiques (télémaintenance).
L'intégration verticale consiste pour une société informatique à non seulement créer un logiciel, mais également travailler sur des opérations antérieures et postérieures au développement du logiciel en question, tels que le management du système d'information, l'aide à la décision de la direction des systèmes d'information, les opérations de migration ou les services d'assistance.
Informatique et développement durable
On applique souvent l'adjectif « virtuel » ou « immatériel » aux produits de l'informatique, ce qui pourrait laisser croire que l'informatique est peu consommatrice de ressources naturelles. Jean-Marc Jancovici montre que la dématérialisation, souvent présentée comme une solution pour le développement durable de l'économie, ne s'est pas accompagnée d'une diminution des flux physiques par rapport aux flux d'information. En pratique, dans les années 2010, les directions des systèmes d'information sont généralement tenues à l'écart des programmes de développement durable des entreprises.
On se rend compte aujourd'hui, avec les premières études des experts en informatique verte (TIC durables), que l'informatique serait directement à l'origine de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. L'informatique générerait également une forte consommation d'électricité. Mais les impacts environnementaux sont surtout concentrés lors de la fabrication des équipements et leur fin de vie. Les principaux impacts sont l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables et les pollutions (eau, air, sol) qui dégradent les écosystèmes....