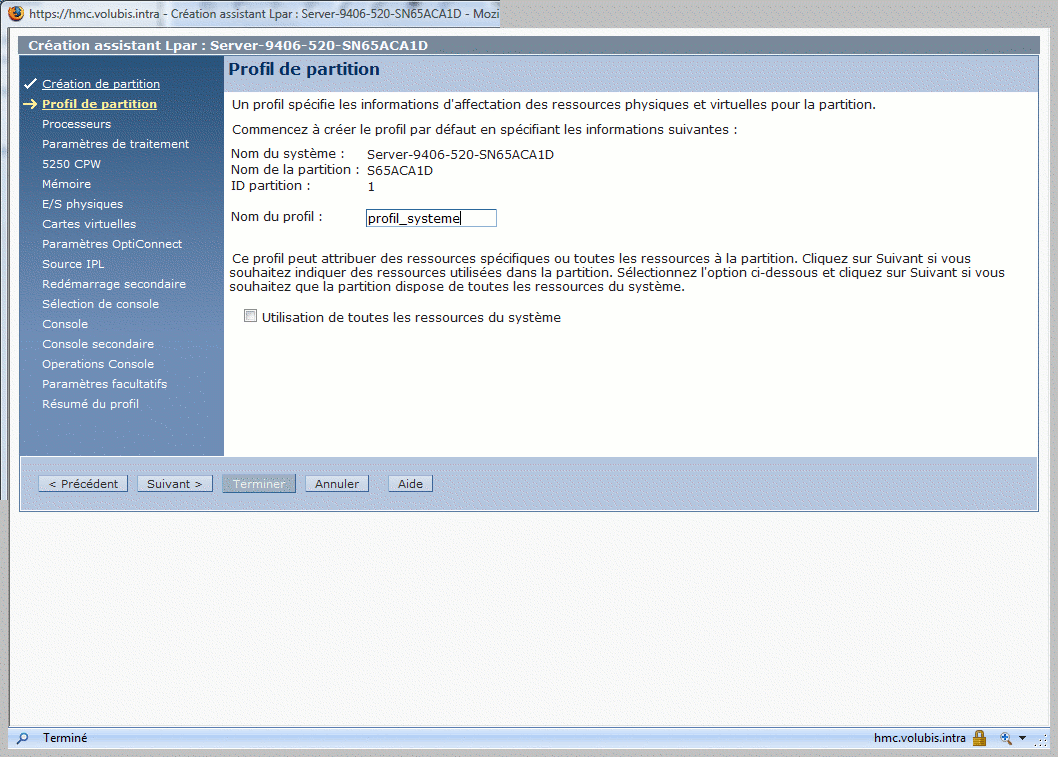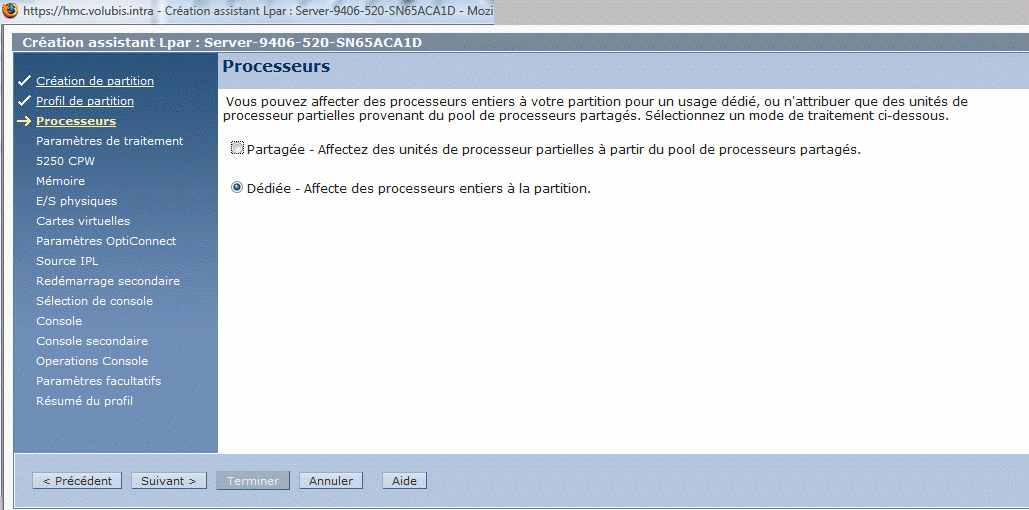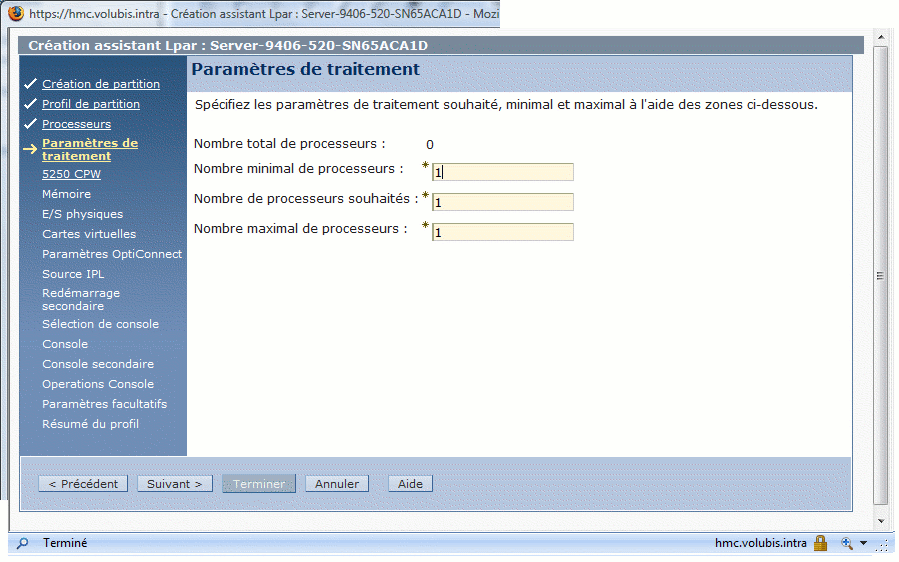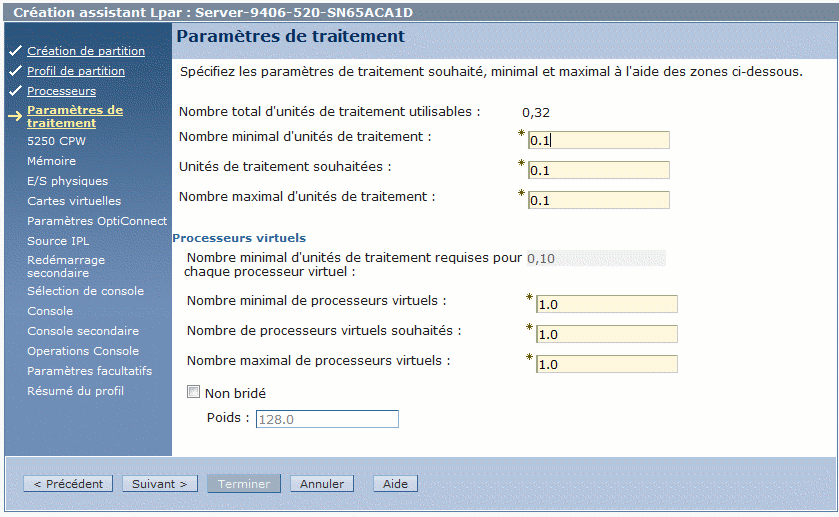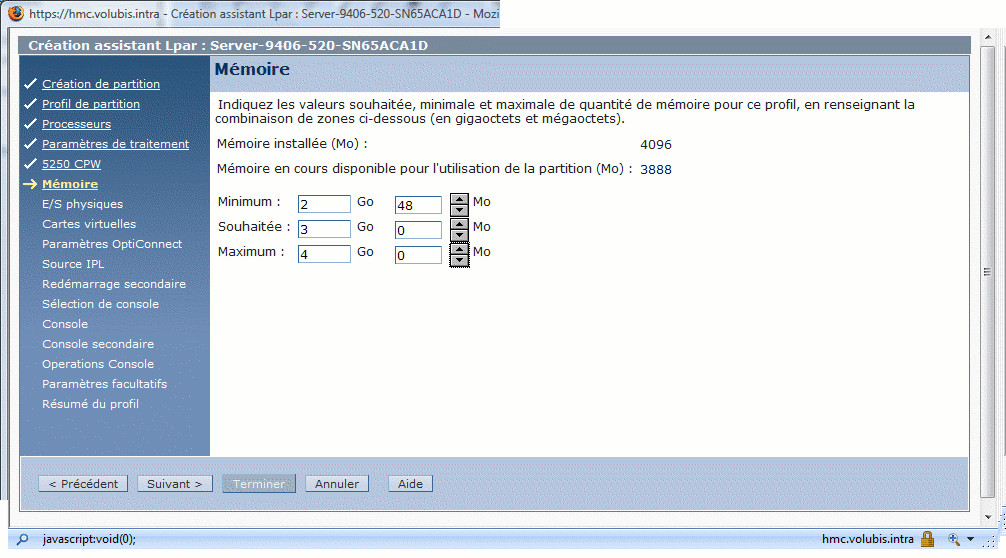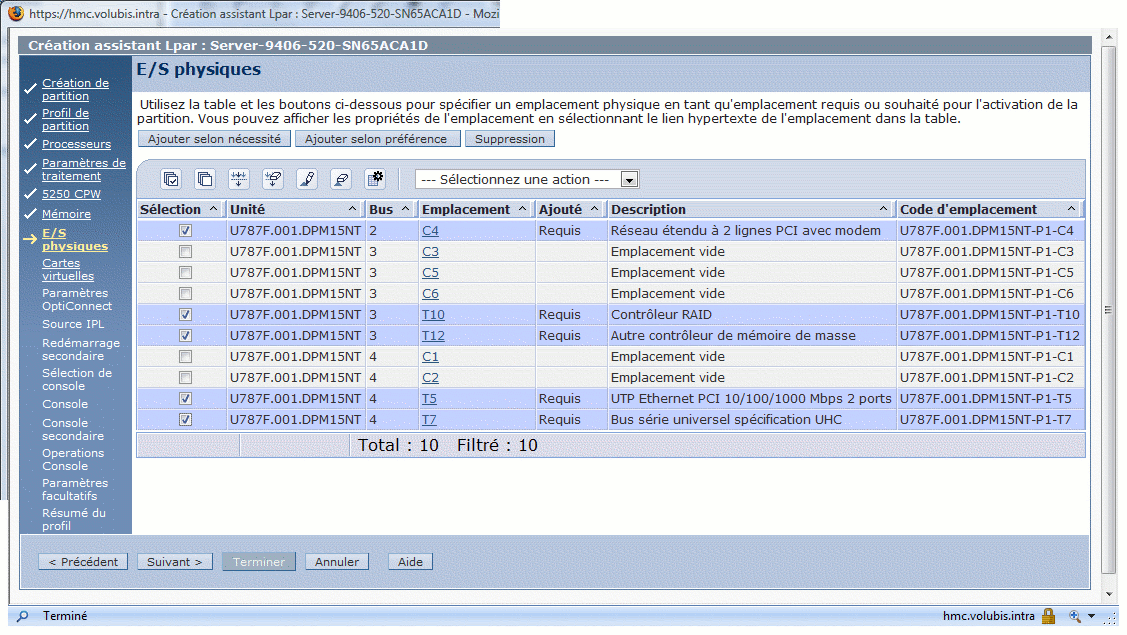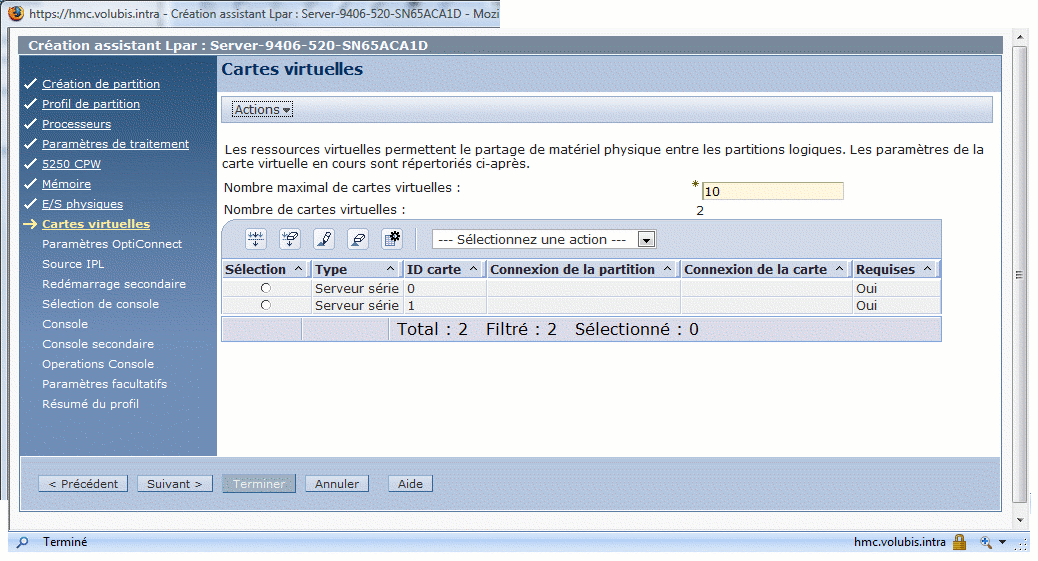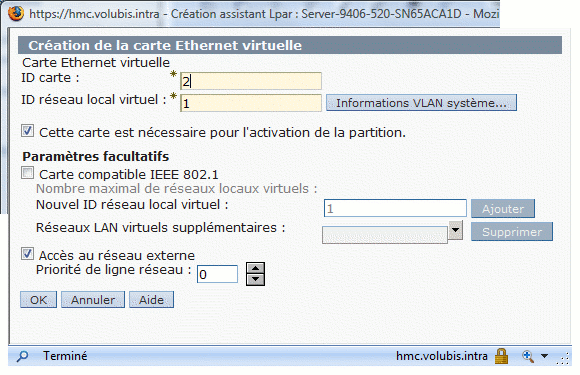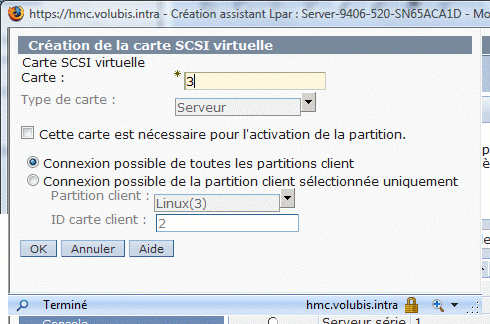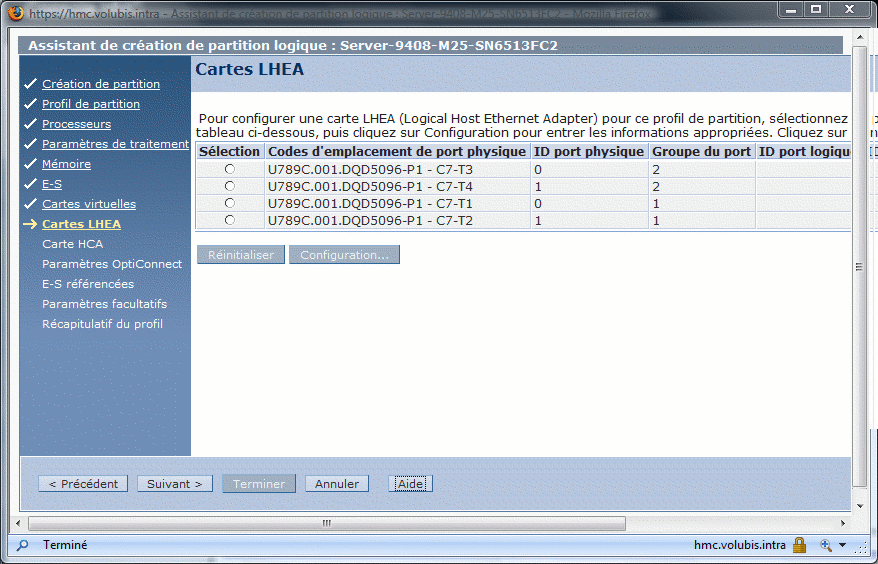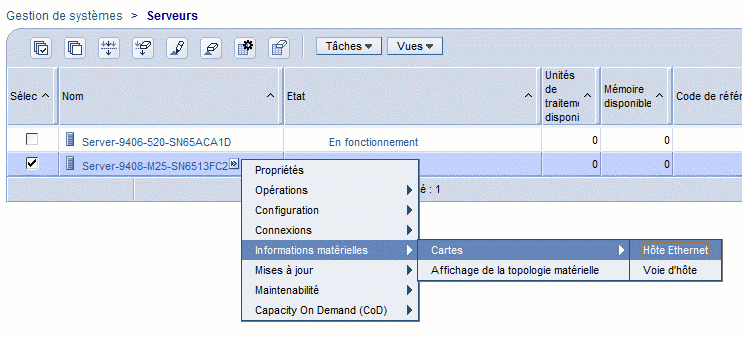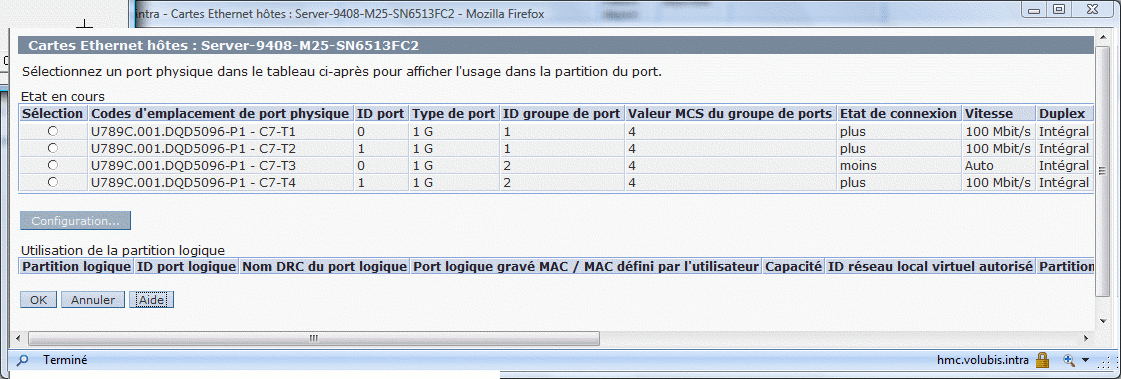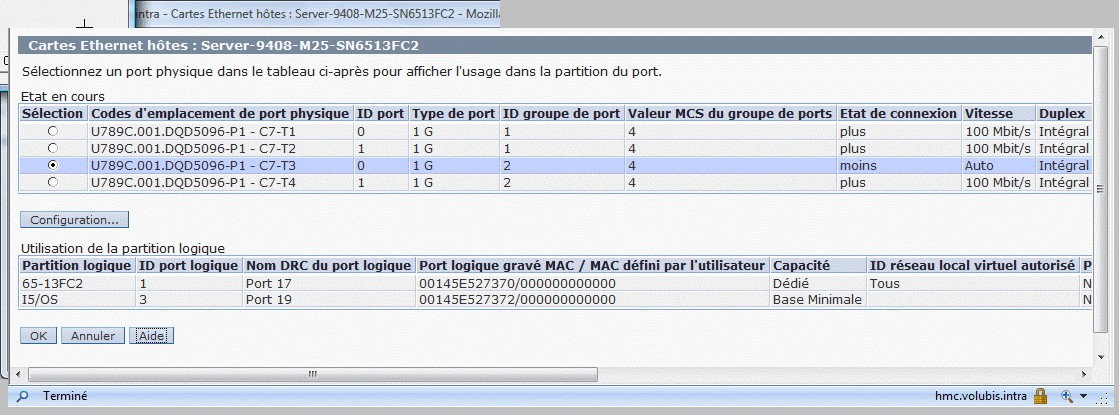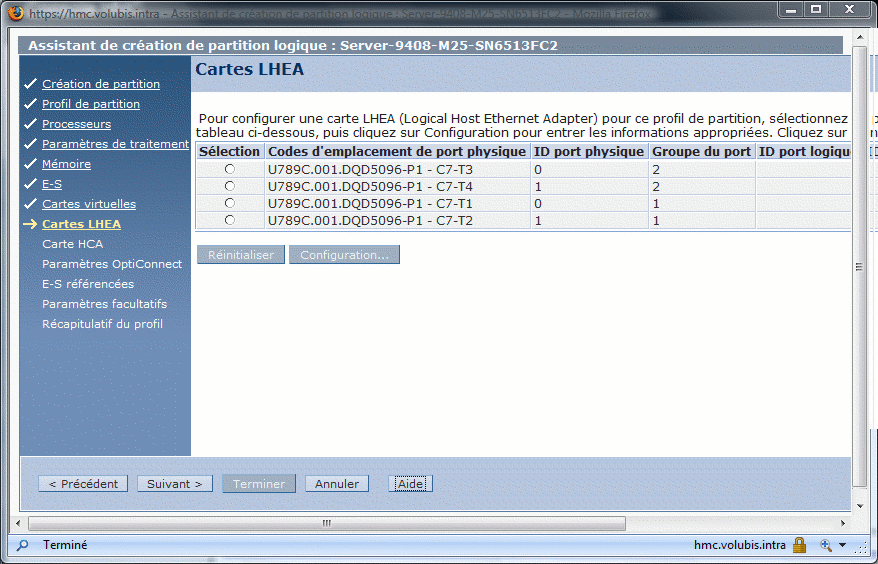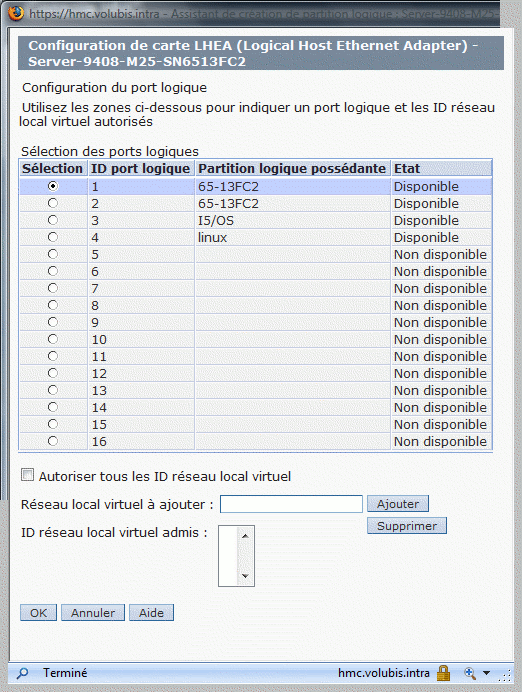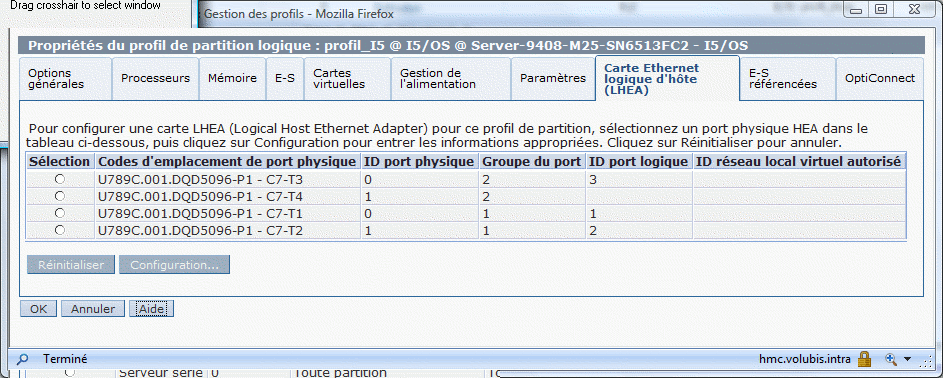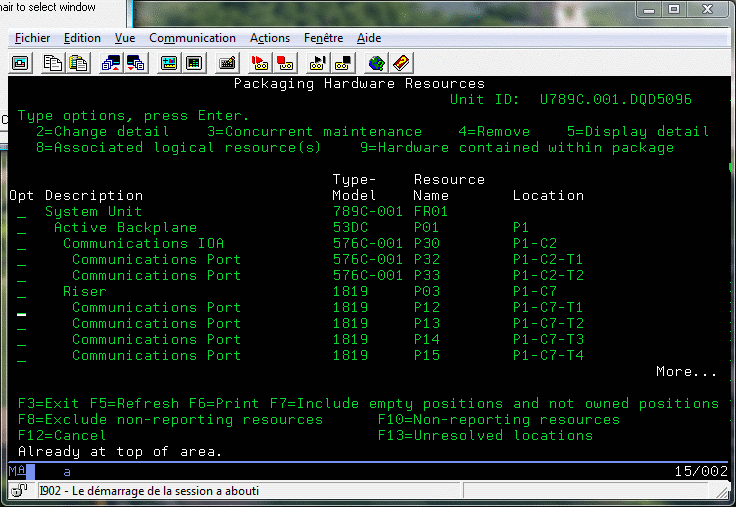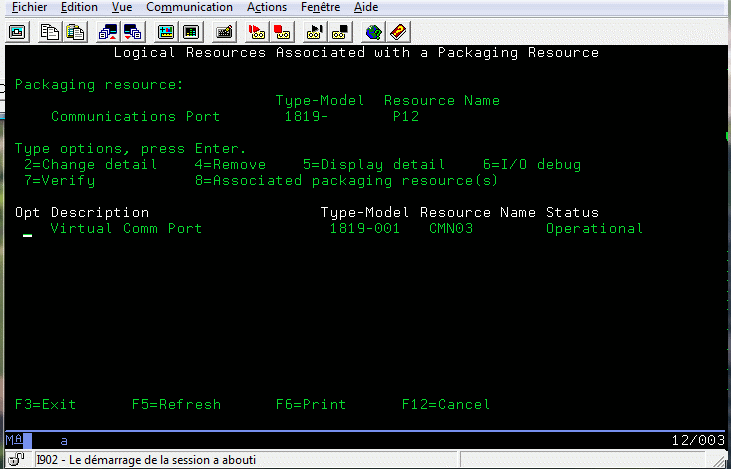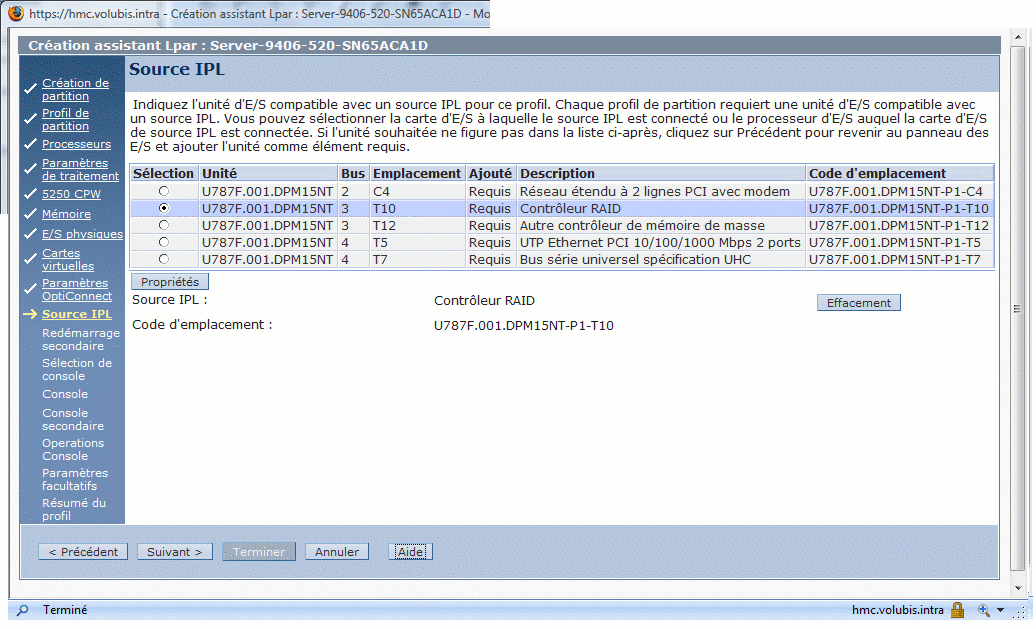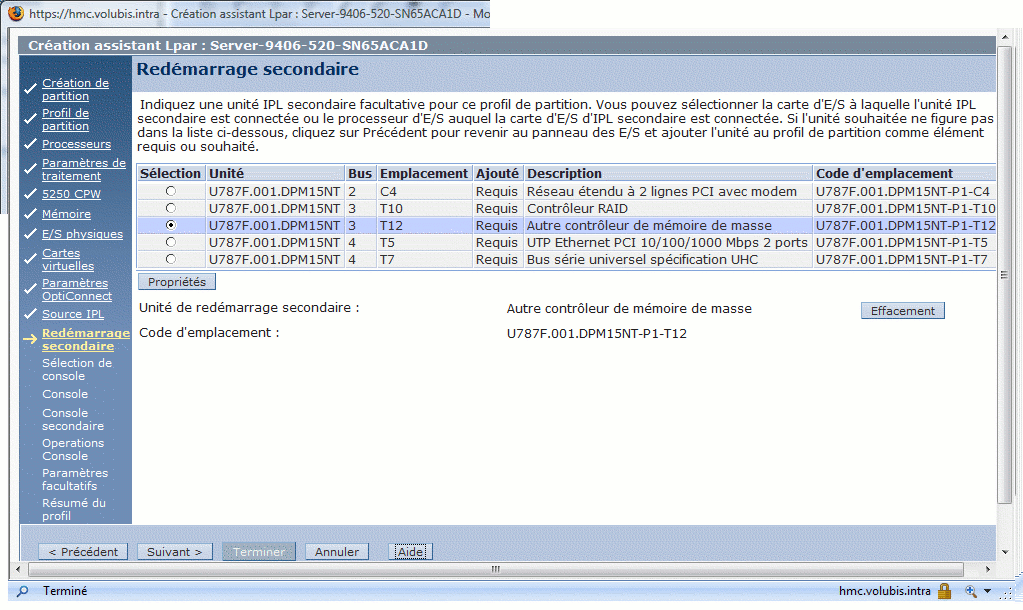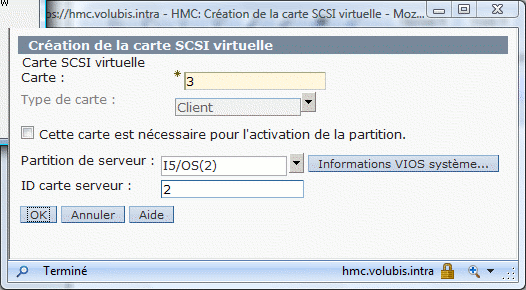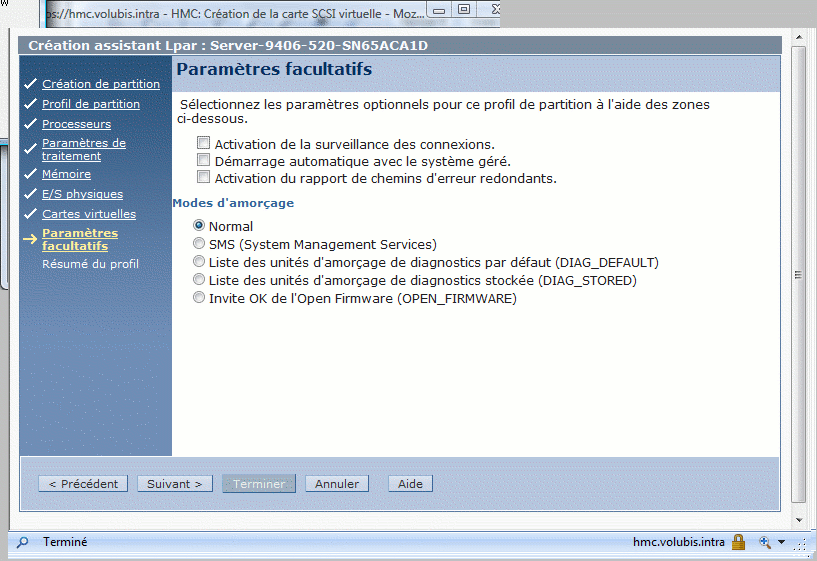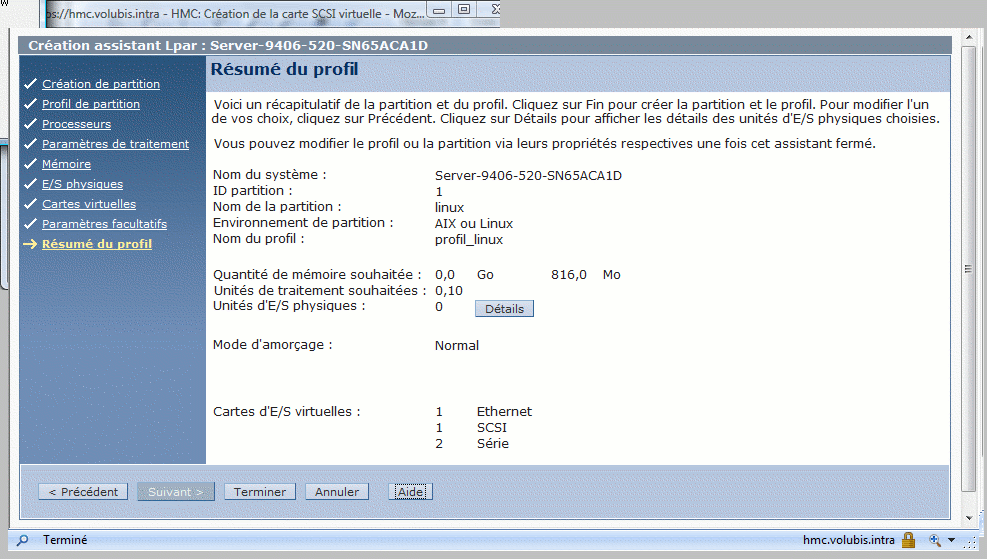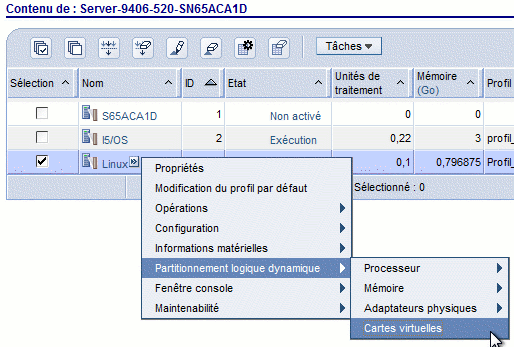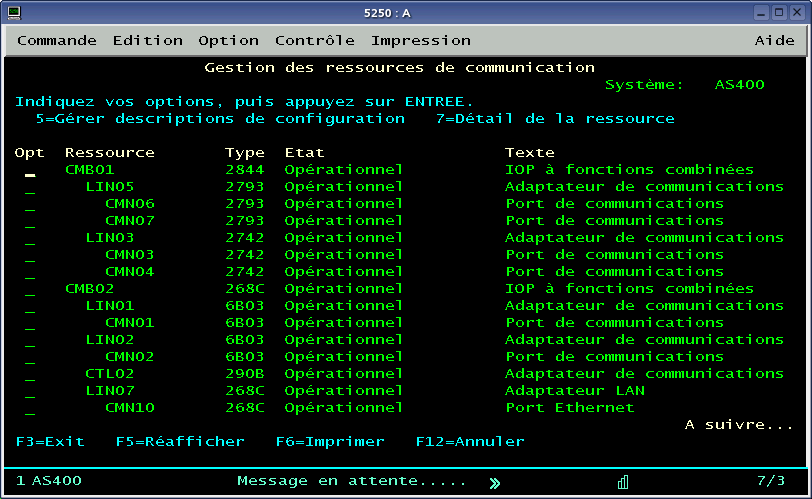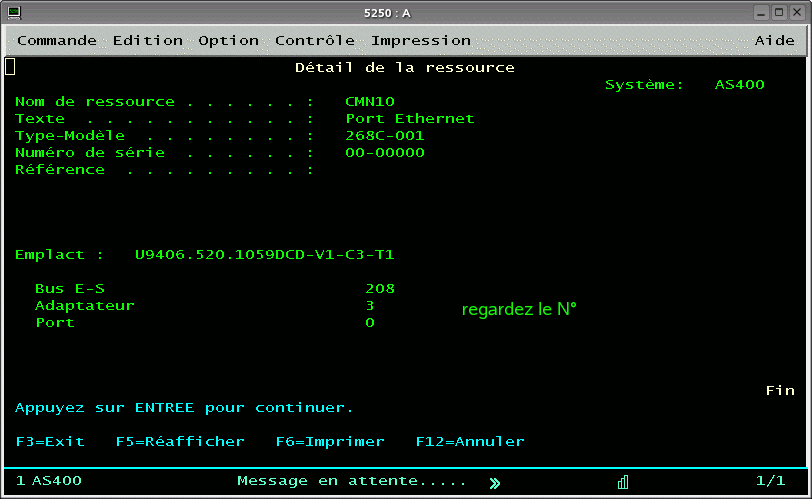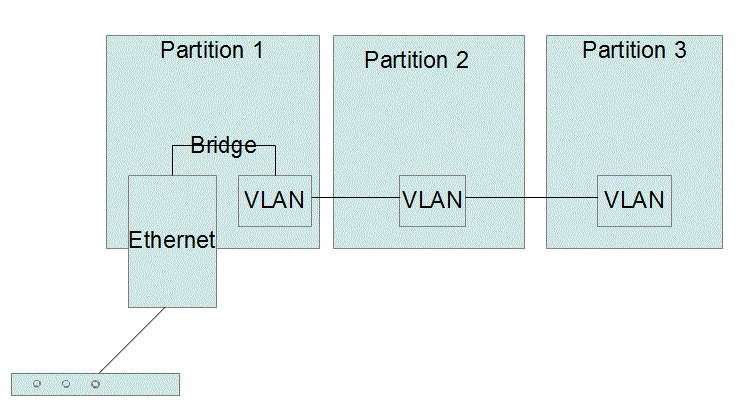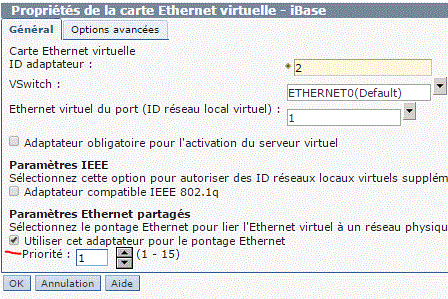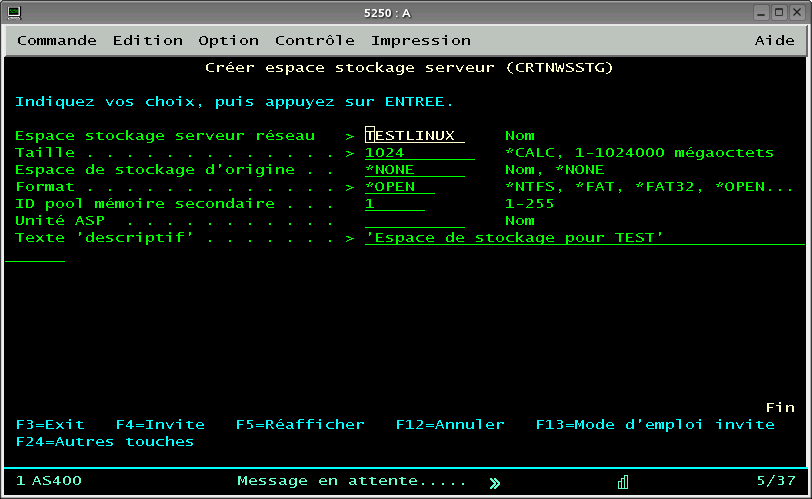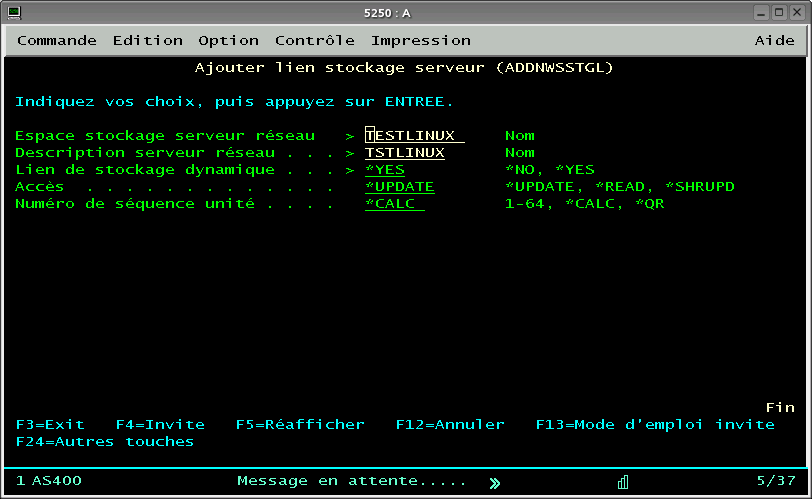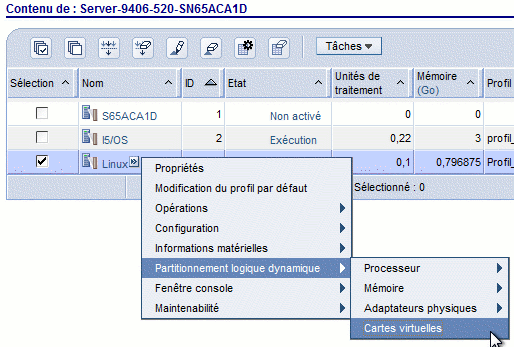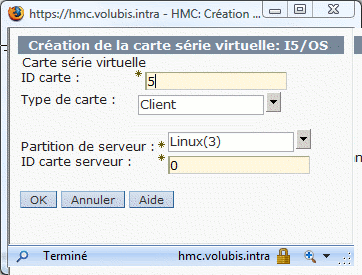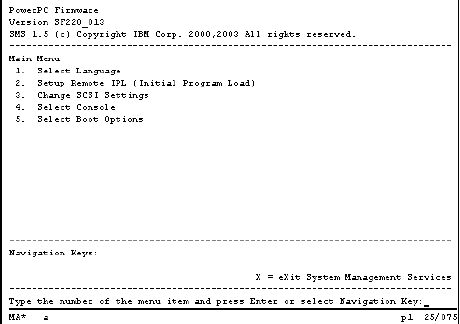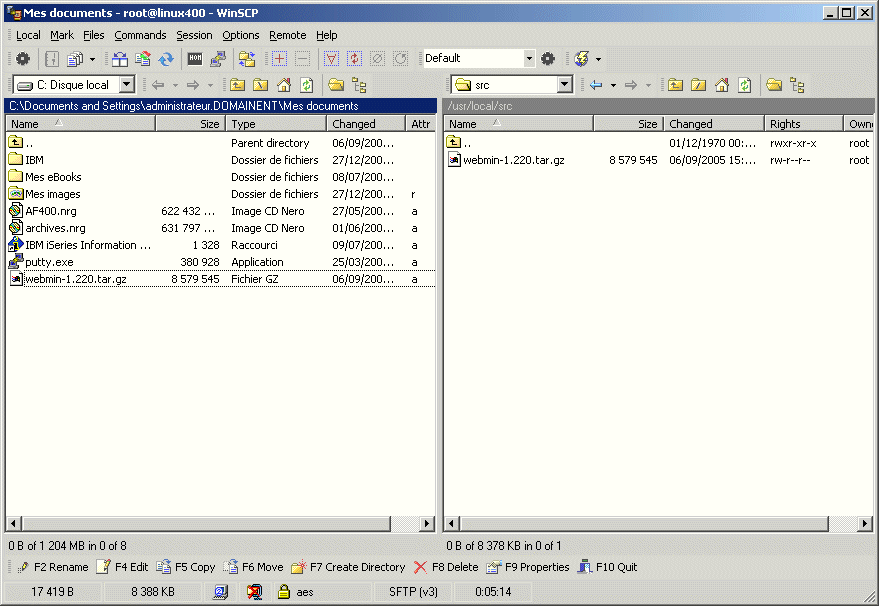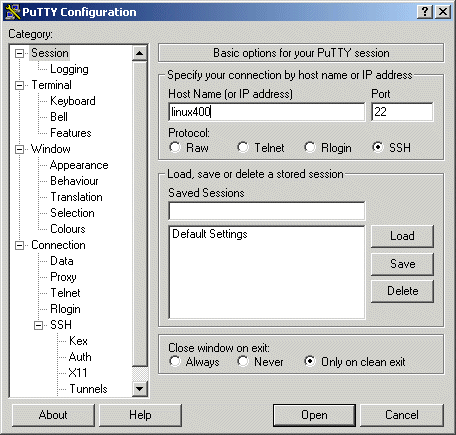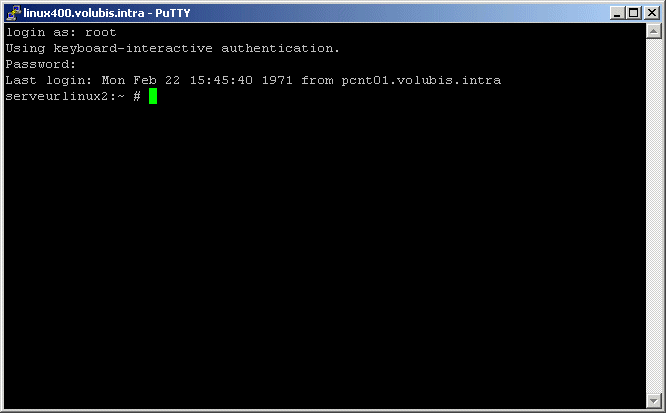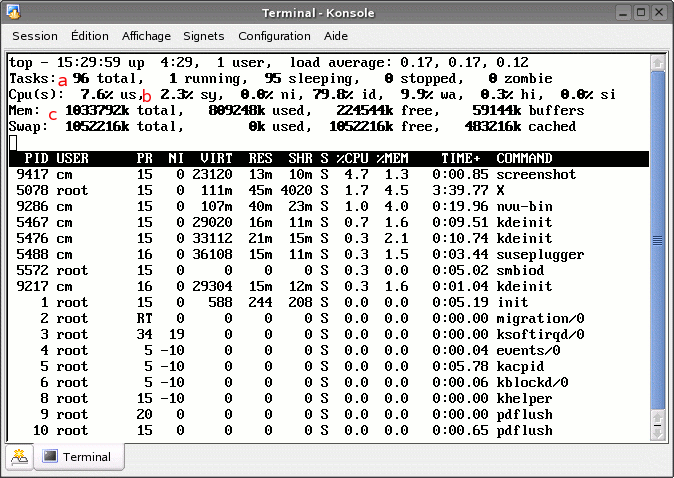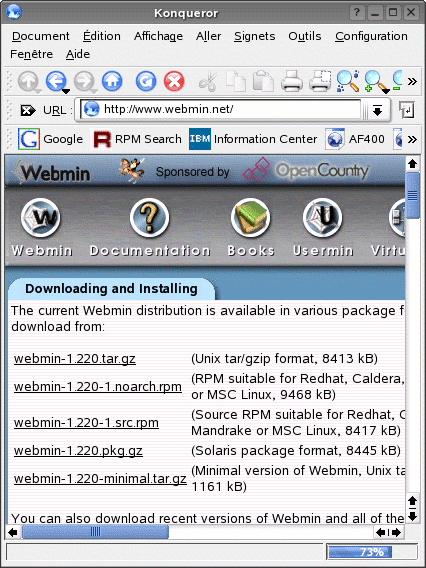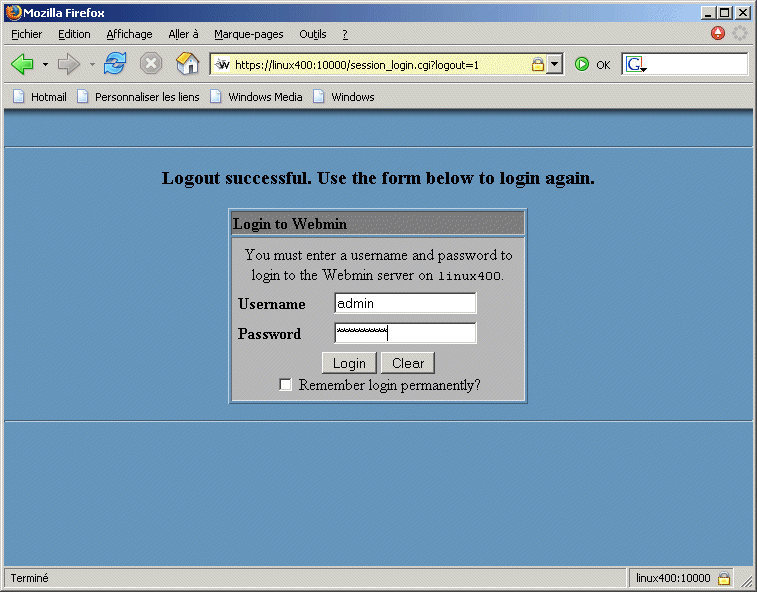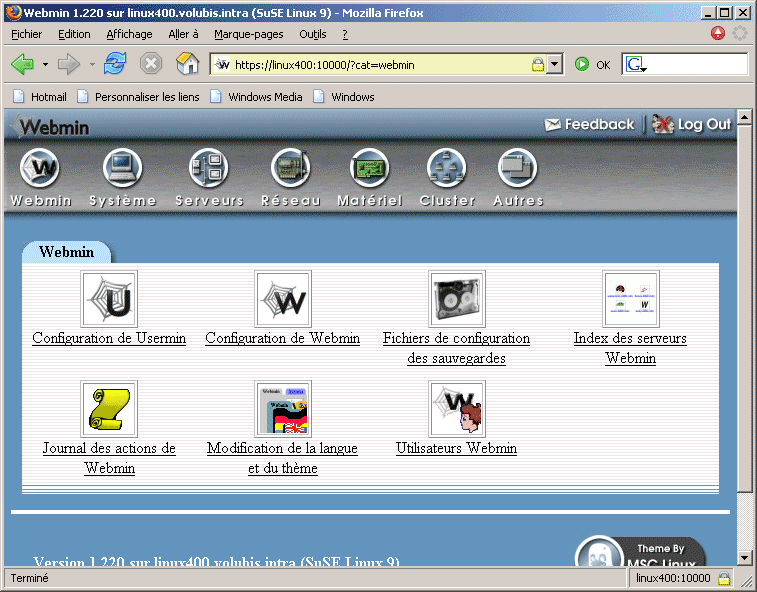LPAR et partition Linux
Pour commencer, vérifiez vos options avec le Lpar Validation Toolkit
(LVT) ou depuis 2006 avec SPT
Cela vous familiarisera avec des notions importantes
-
partition / type de partition
-
unité de traitement / processeur virtuel
-
hardware associé / load source
SI ce n'est pas le cas, voyez le cours correspondant
Passons à la partie conception de la partition Linux
sur HMC (ici la version 7)
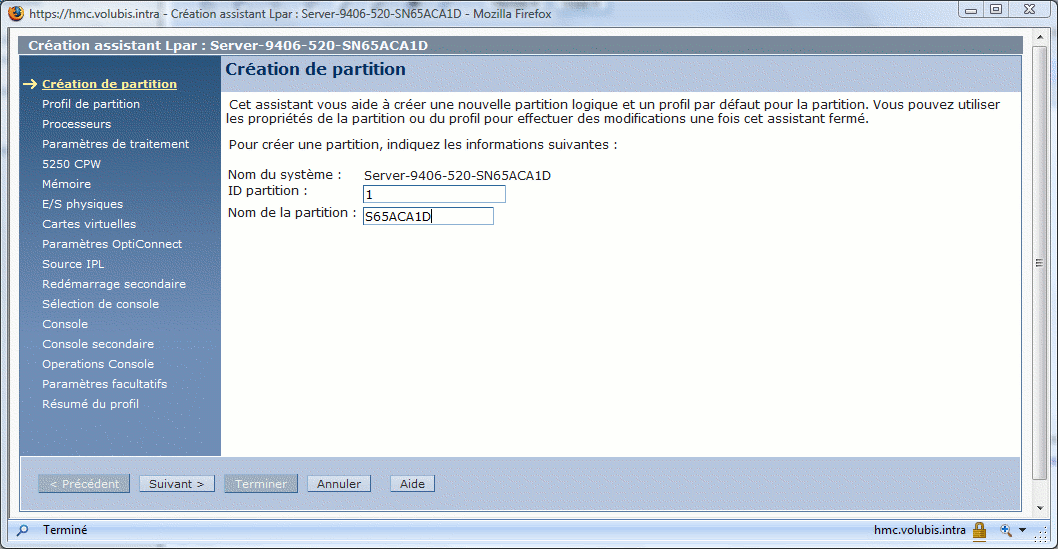
Indiquez un id de partition (n° unique) et un nom
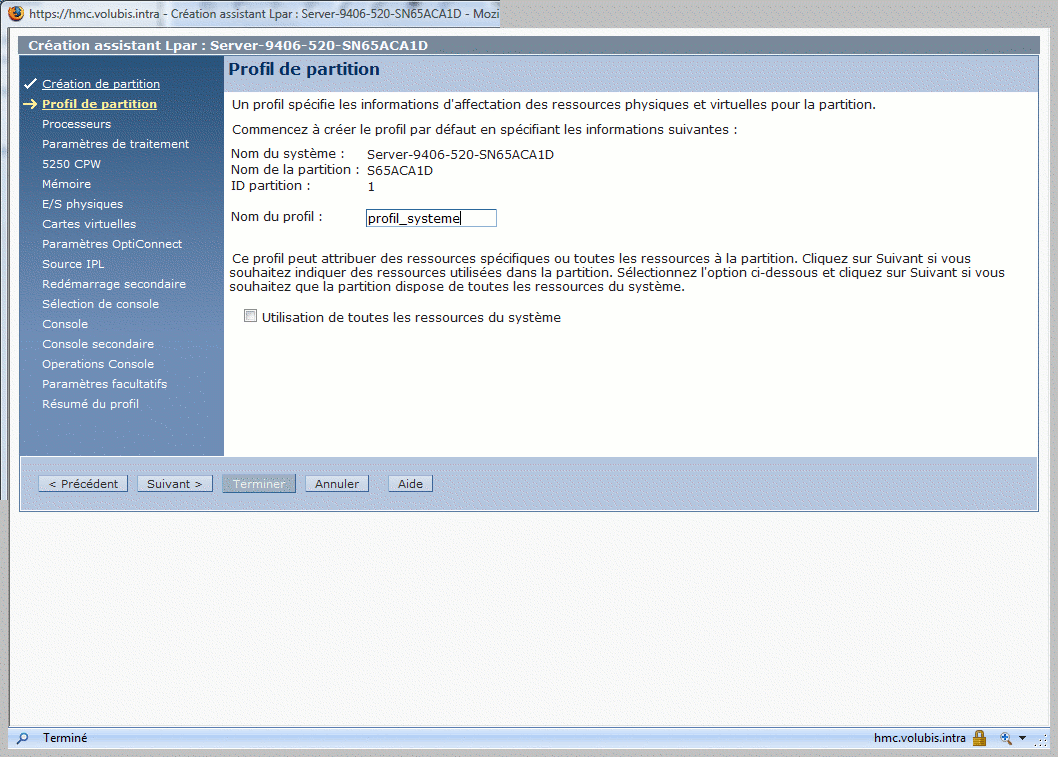
un texte explicatif (ne cochez pas "Utiliser
toutes les ressources...")
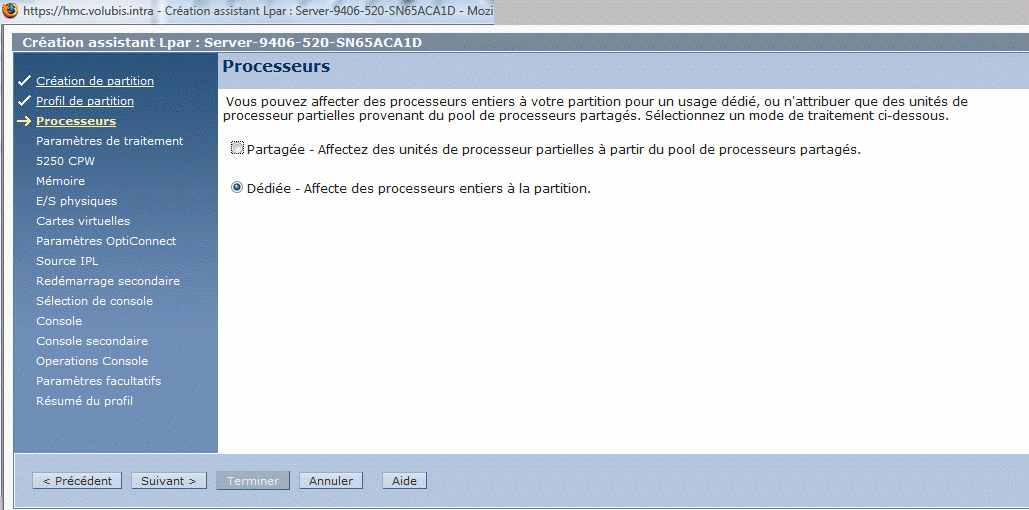
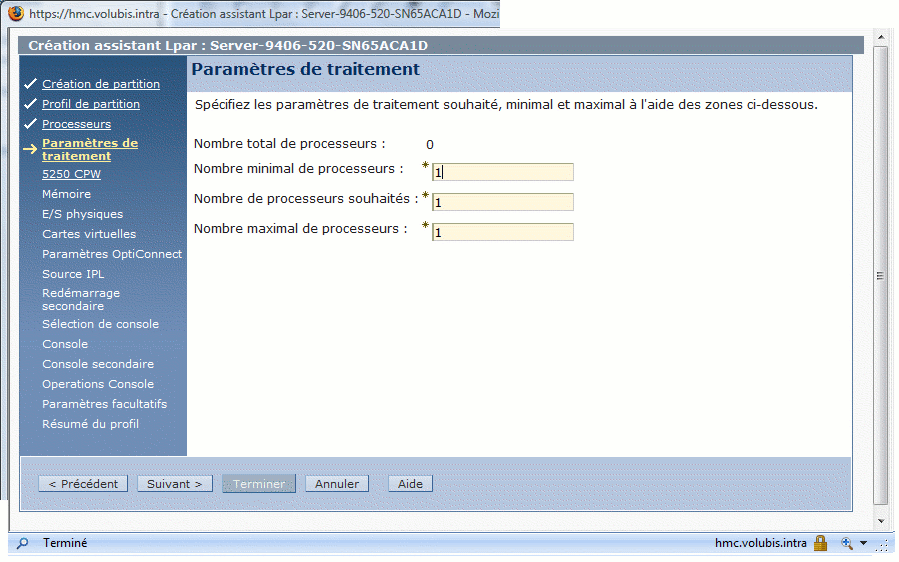
puis les unités processeur telles que vues avec le validation toolkit
Si vous choisissez partagés, vous verrez
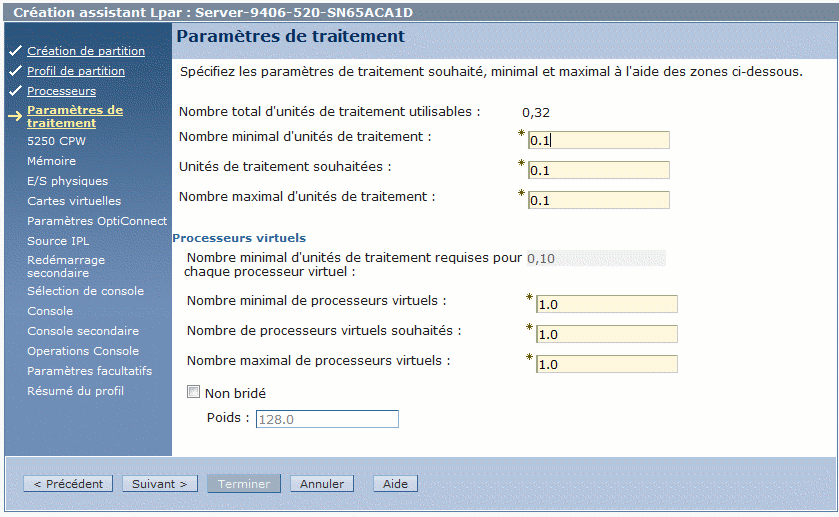
Si vous choisissez non bridé (uncapped en V6) , il faut
alors attribuer à cette partition un poids (valeur entre 1 et 255)
En
cas de conflit (besoins concurrents), c'est la partition avec le poids le plus
fort qui sera servie, proportionnellement au poids indiqué
(une partition avec un
poids de 180 a deux fois plus de chance d'avoir de la CPU qu'avec un poids de
60)
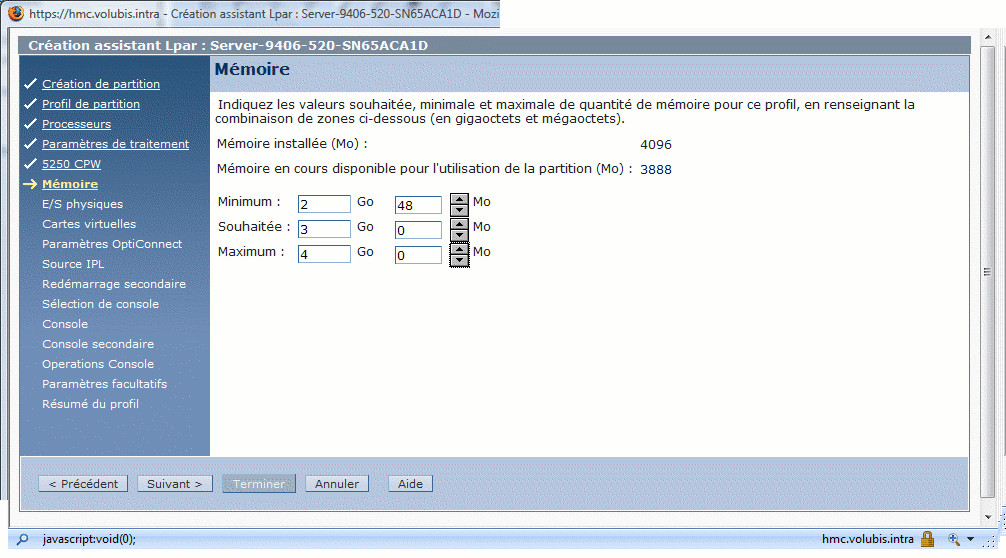
puis la mémoire minimum et la mémoire souhaitée (toujours
des multiples de 16 Mo)
si le système le peut, il alloue la mémoire souhaitée,
s'il n'arrive pas à allouer la mémoire minimum,
le démarrage de la partition échoue.
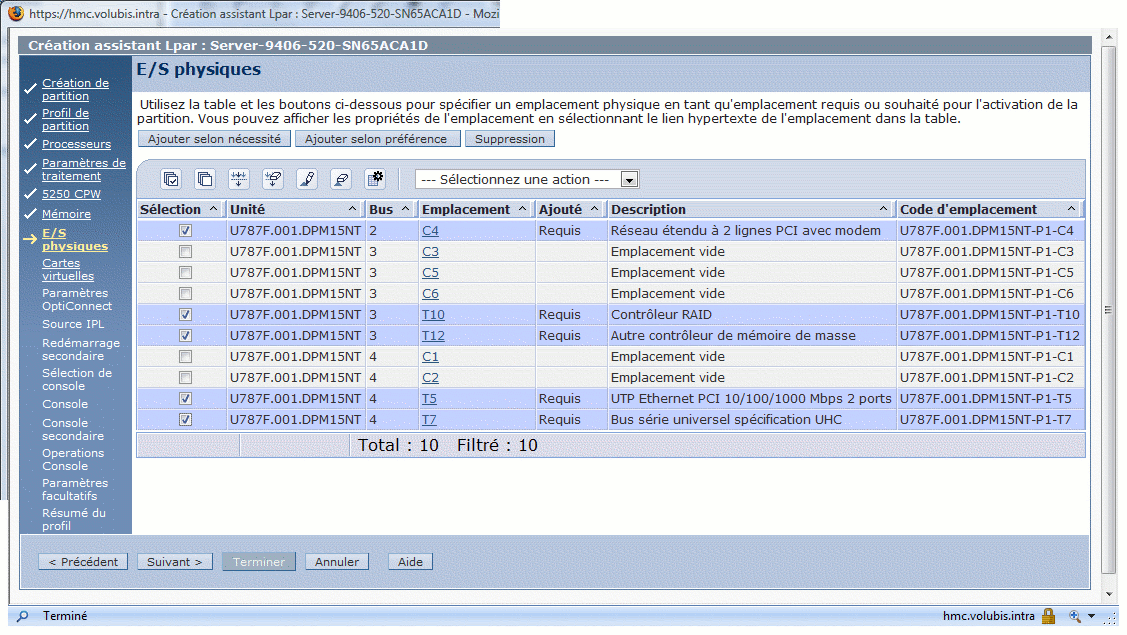
Indiquez ensuite le hardware dédié à cette partition (il
peut ne pas y en avoir sur une partition hostée)
Sur des systèmes à base de POWER6, la carte réseau est allouée différemment
(voir LHEA plus loin dans ce cours)
Nous passons ensuite à la définition des I/O virtuelles
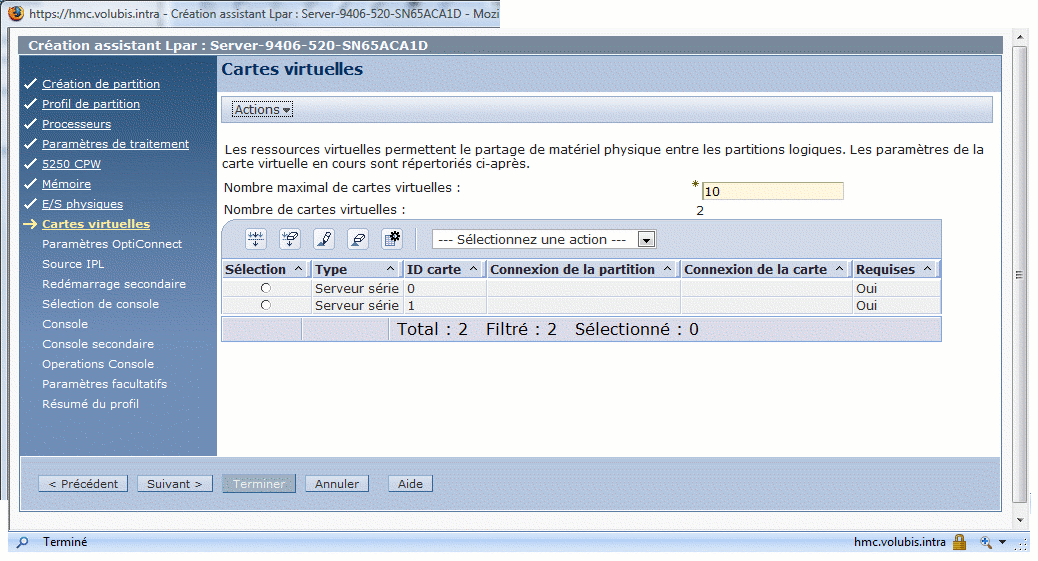
chaque partition possède automatiquement deux adaptateurs virtuels de
type console
Il s'agit ici de créer de nouveaux adaptateurs :
- un adaptateur virtuel de type ethernet pour le VLAN
- un client SCSI pour l'utilisation des disques I5/OS (un serveur de même
type doit exister coté I5)
- Voyez si vous devez cocher "Cette carte est nécessaire..."
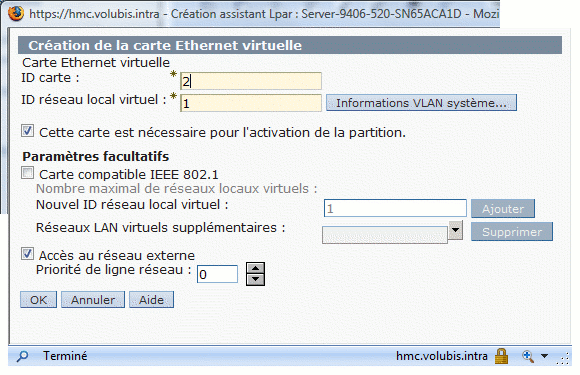
Indiquez ici, un LAN ID, le même que sur la partition I5 (à créer
s'il n'existe pas)
cochez "Accès au réseau externe" (trunk adpater en V6)
uniquement sur la partition qui sert de passerelle,
et si vous avez un Virtual I/O serveur (AIX) ou une partition IBM i en V7 (voir plus loin dans ce cours)
Sur la partition I5/OS, il faut un adaptateur virtuel de type serveur SCSI ?
(créez le, s'il n'existe pas) et mémorisez
son emplacement (n° carte).
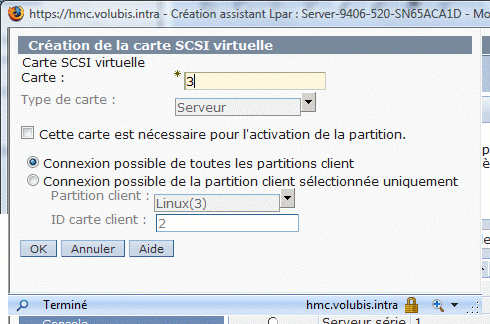
Sur un système Power6, indiquez les cartes L-HEA (Logical Host Ethernet
Adapter) associées à cette partition
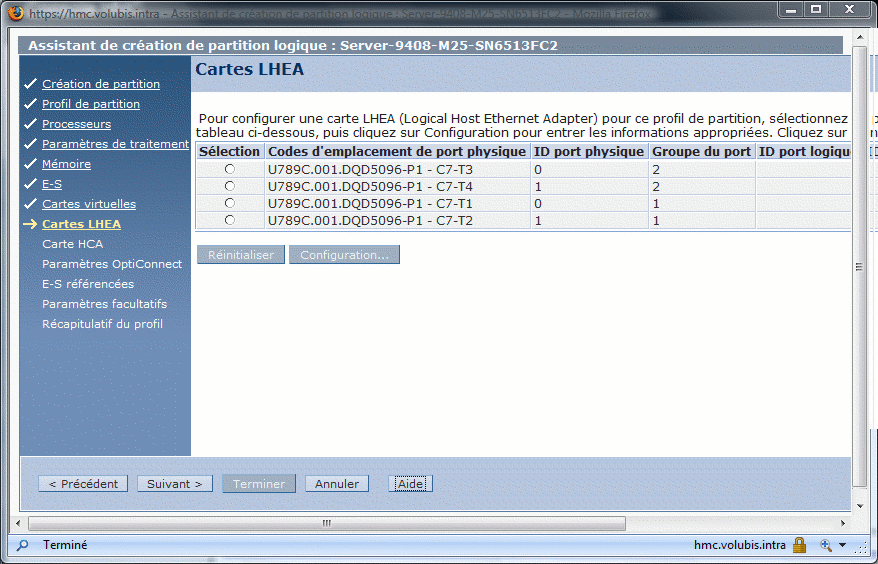
Cette notion est nouvelle avec les Power6. Il s'agit de nouvelles cartes
réseau (5636-2 ports/5639-4 ports) directement branchées sur
le BUS GX+
les ports sont associés à un groupe (1 ou 2 groupes, avec 2
ports
chacun)
chaque
groupe
supportant
16
MAC
adresses
différentes.
On peut donc définir 16 à 32 cartes virtuelles (la gestion des cartes
physiques étant à la charge du FIRMWARE)
- Cliquez sur le système et choisissez
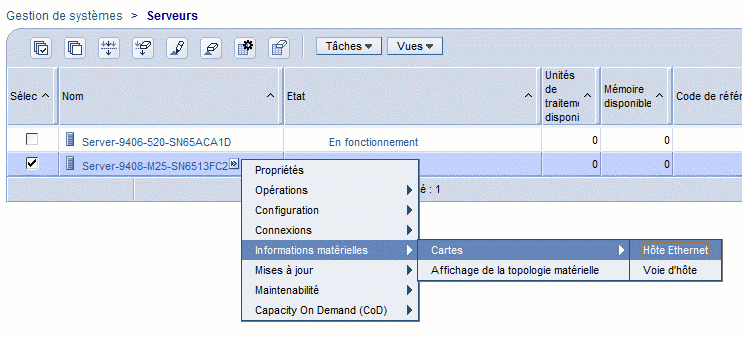
Pour chaque port vous configurerez le MCS (Multiple Core Scaling, qui
définissent le nombre de Queue internes disponibles pour chaque partition)
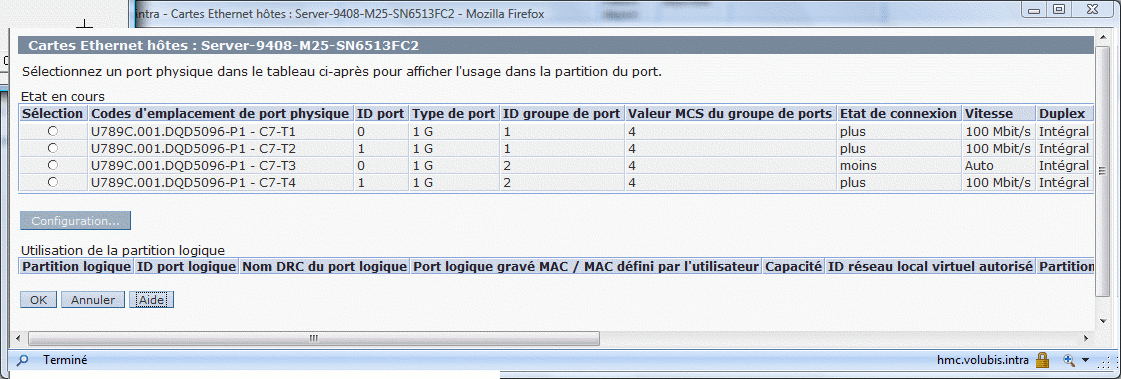
Appuyez vous sur le tableau ci-dessous (pour le 5639 / 4 ports)
| MCS |
ports logiques maxi |
ports logiques par partition |
| 1 |
16 |
4 |
| 2 |
8 |
4 |
| 4 |
4 |
4 |
| 8 |
2 |
4 |
| 16 |
1 |
2 |
La machine est livré avec un MCS de 4 par défaut
En demandant le détail, vous voyez les partitions associées à un port
et les adresses MAC logiques
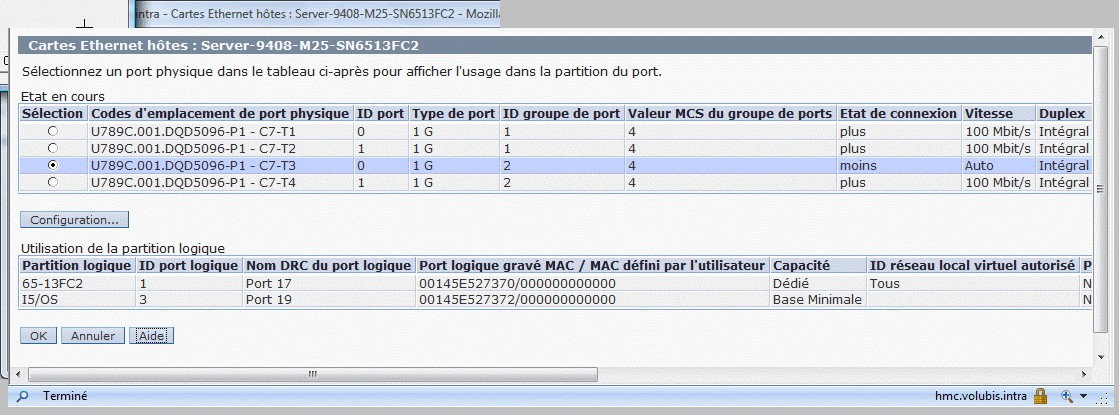
Revenons à notre définition de partition
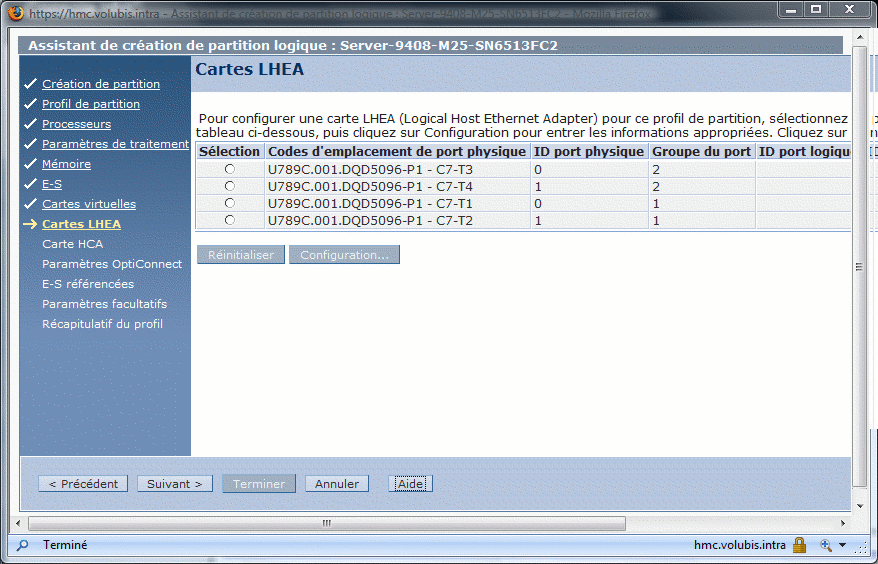
Choisissez un port physique et attribuez lui un port logique pour cette
partition par "Configuration..."
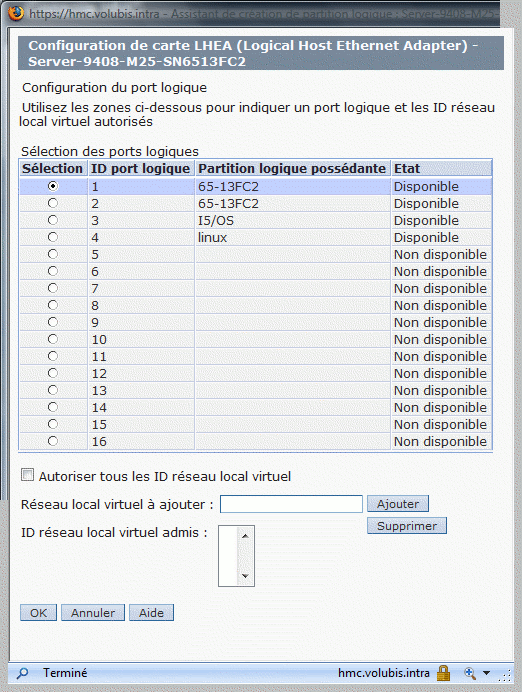
Une fois la partition terminée, vous retrouverez cette définition au
niveau du profil
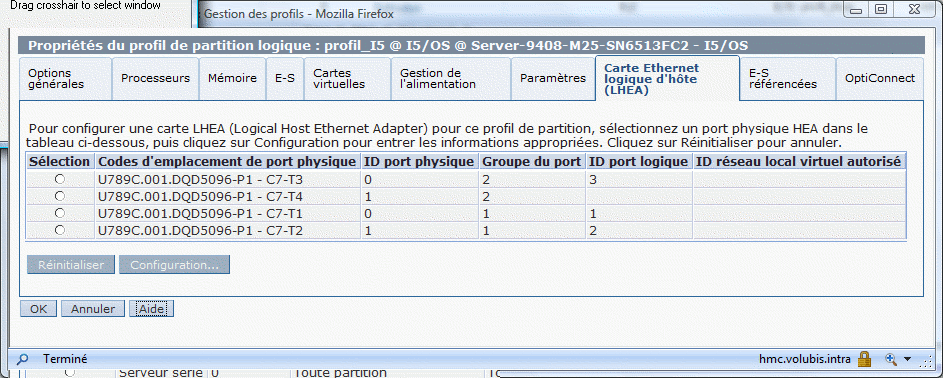
et sous SST (STRSST, 1/Start a service tool, 7/Hardware service manager
, option 1)
Vous verrez des cartes de type 1819
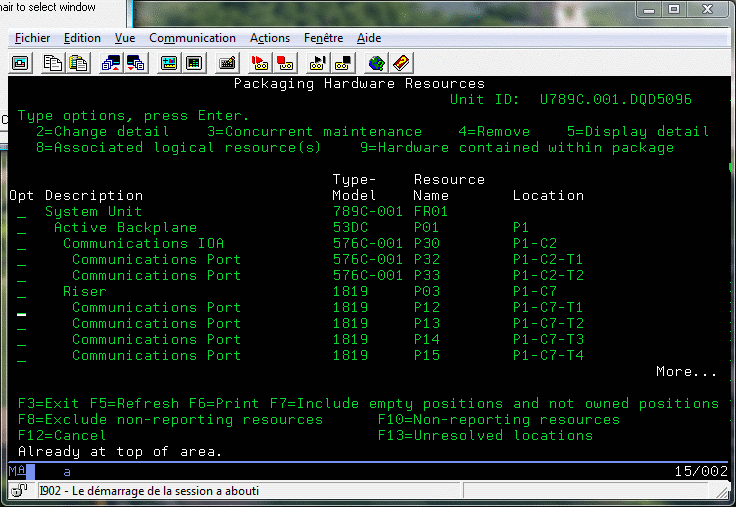
L'option 8 vous montrant les
ressources logiques associées, utilisables dans vos créations de ligne.
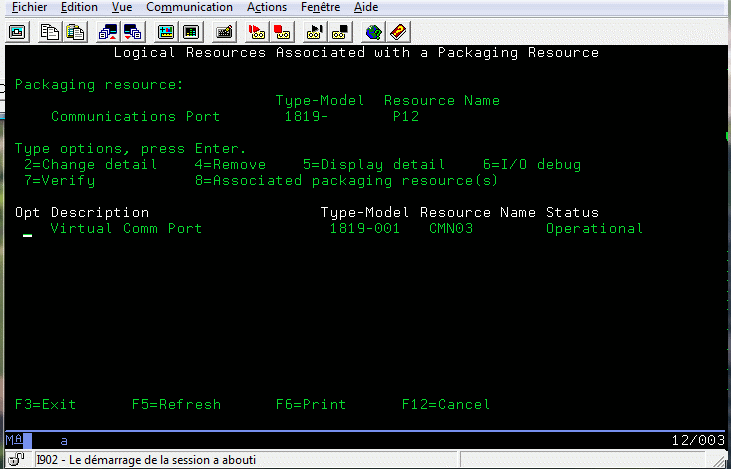
- Revenons à notre définition de partition I5/OS,
vous devrez indiquer ensuite la source d'IPL primaire (votre
contrôleur
de disques RAID)
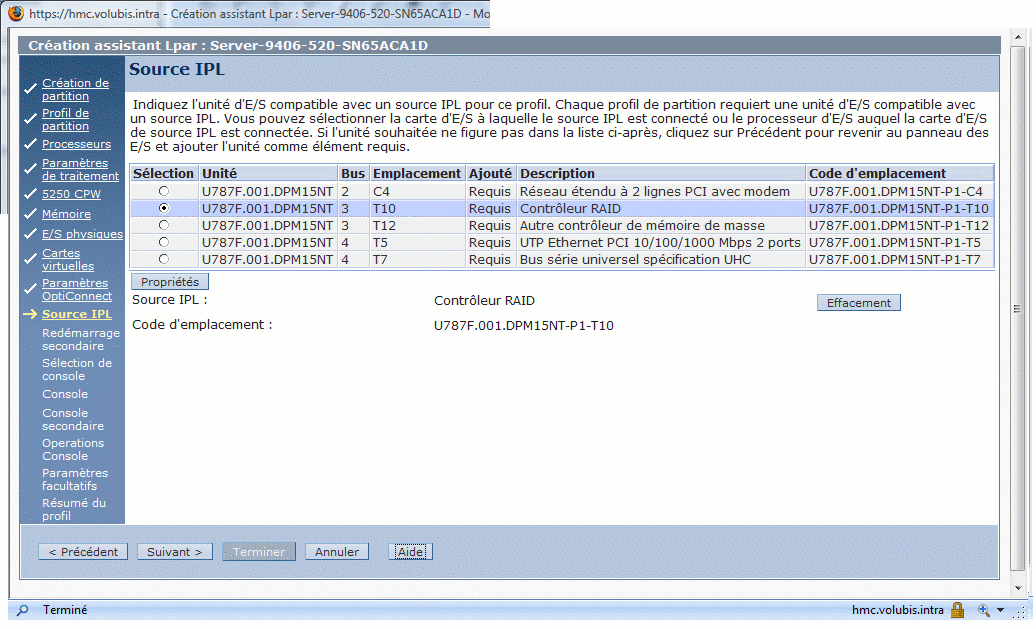
Secondaire
Le lecteur de CD-ROM
Attention sur les systèmes IOPless (lecteur CD et dérouleur
de bande sans carte MFIOP, sur certains POWER5+ et TOUS les Power6),
il faut indiquer aussi le contrôleur de disques à cette étape,
il gère lui même l'IPL D.
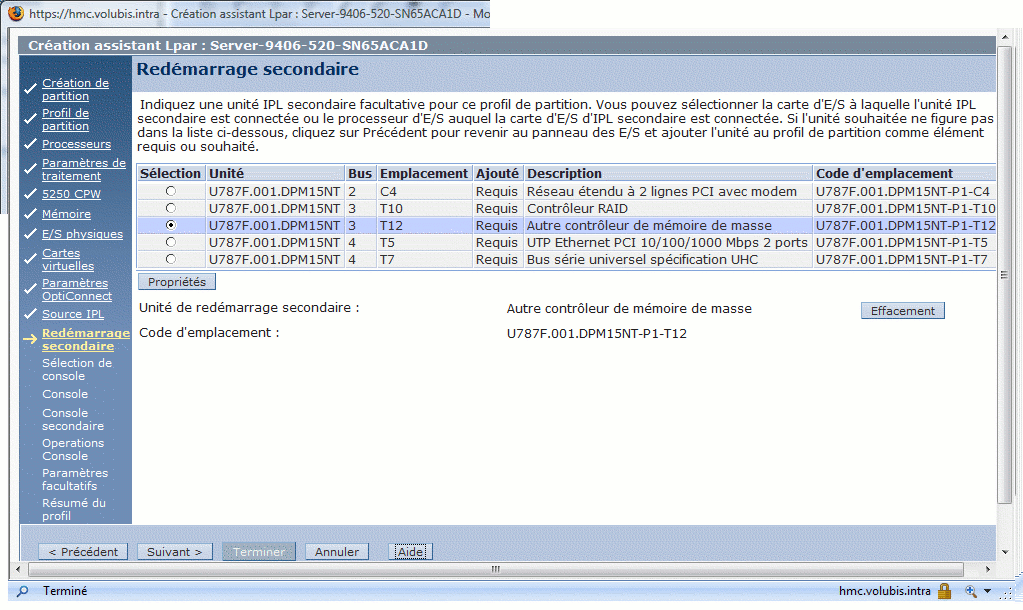
puis la console

Sur une partition Linux, utilisez LHEA ou créez un adaptateur Ethernet virtuel
Puis associez des disques ou
créez
un adaptateur virtuel SCSI de type client
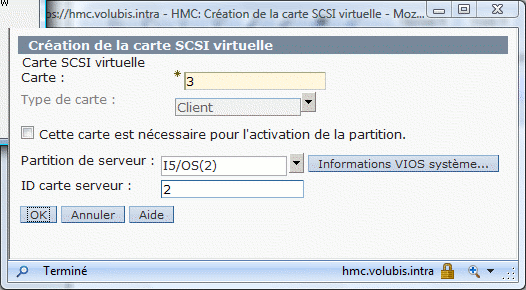
indiquez alors :
- la partition I5/OS
- le n° de carte serveur vu
plus haut
l'étape suivante consistera à indiquer la partition de gestion
de l'alimentation (virtuelle), étape obligatoire pour une partition "hostée".
en contrepartie, n'indiquez pas un démarrage automatique avec la machine
(cette partition ne peux pas démarrer,
tant que la partition I5/OS ne l'est pas)
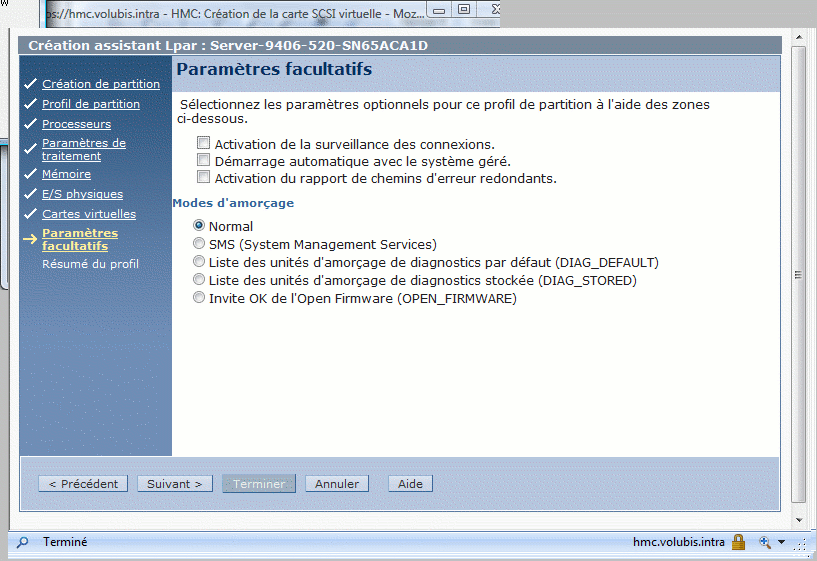
Notez la case à cocher "Autorisation de la collecte des informations de performance", qui permet une analyse de l'activité matériel
à travers IBM Navigator Director, nommé maintenant IBM Navigator for i.
(Performances/Etudes de données/ Service de collecte/Système physique)
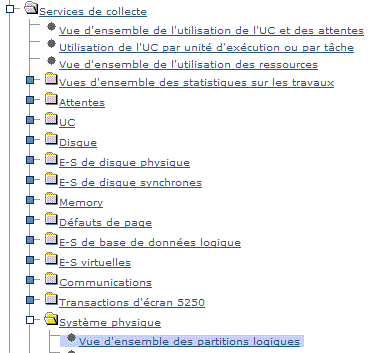
Ici, la consommation UC (bridé/non bridé) par LPAR
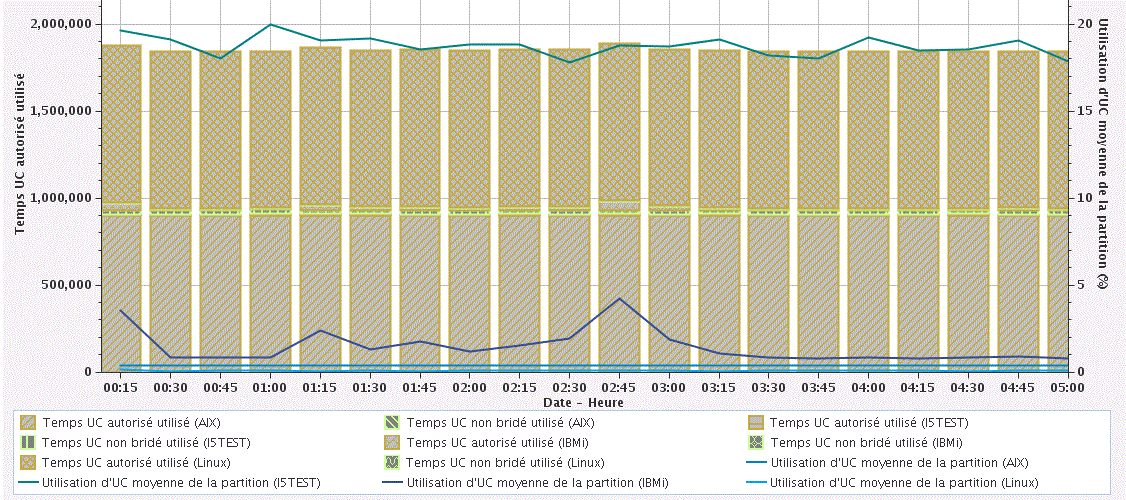
Choisissez le type de démarrage (SMS à la première utilisation,
ensuite Normal qui est par défaut)
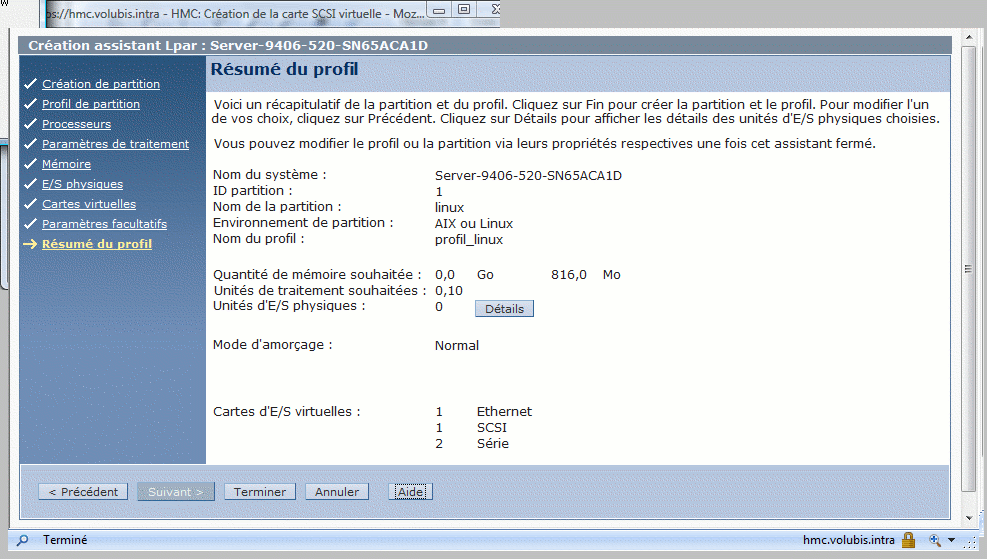
et terminez sur cet écran récapitulatif en cliquant Finish.
Si vous souhaitez ajouter une carte virtuelle sur une partition existante et
active, vous pouvez maintenant en passant par :
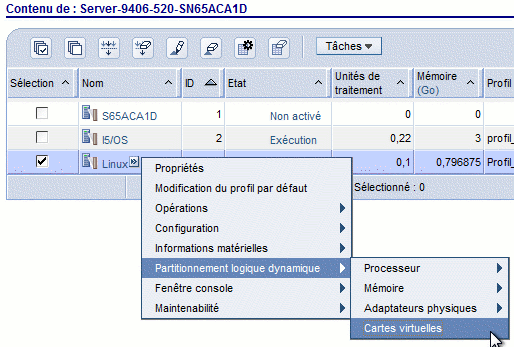
voilà, la partie HMC !
démarrez la partition, pour voir (on en restera au mode SMS, les disques
virtuels étant, pour l'instant, absents)
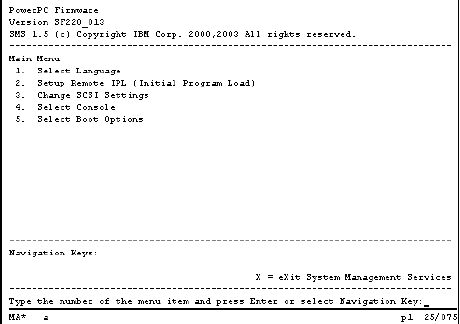
Regardez et corrigez les éventuels messages d'erreur, puis arrêtez
de nouveau cette partition.
Passons à la partie configuration I5/OS.
il faut repérer les deux adaptateurs virtuels créés sur
la partition I5/OS
- de type 290B (notez CTL02) pour
le serveur SCSI (disques), pour le futur serveur de réseau (*NWSD)
- de type 268C (notez CMN10) pour
le LAN virtuel, carte ethernet pour créer une ligne
(facultatif avec LHEA)
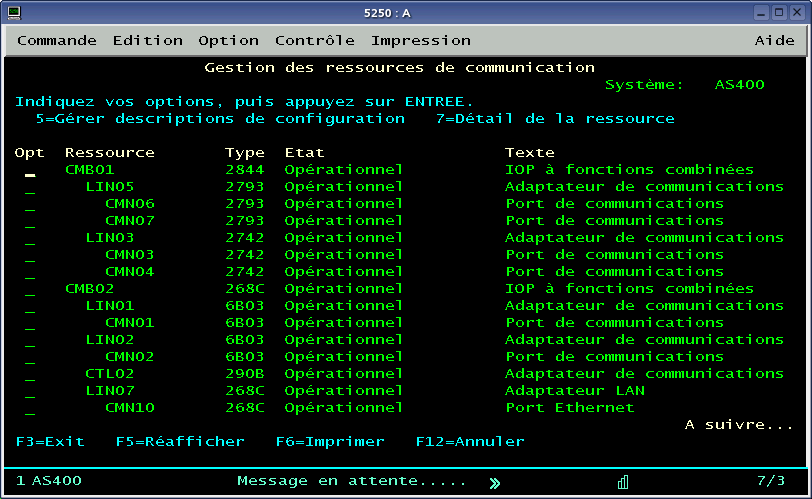
l'option 7 affiche du détail concernant un adaptateur
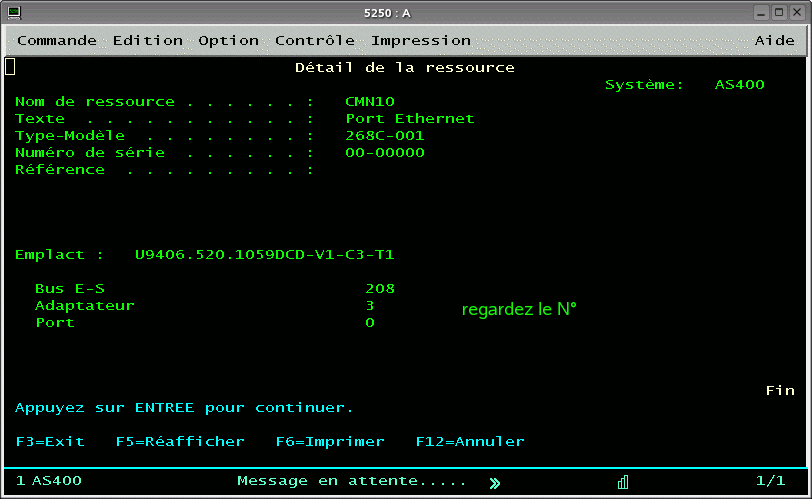
ici, l'adaptateur LAN, ayant un slot id de 3
vous pouvez aussi lire l'emplacement : V1-C3-T1 signifie le premier port
ethernet (T1) de la partition 1 (V1) à l'emplacement 3 (C3)
Cette notion de LAN virtuel fera apparaître :
Dans votre partition Linux une ressource eth0 (comme une carte LAN)
Dans votre AS/400 une ressource de type 268C (vue par wrkhdwrsc, plus haut)
-> vous devrez alors créer une ligne ethernet sur cette ressource
à 1G bits/seconde (cette carte est toujours gérée par la CPU)
-> Il faudra ensuite associer à cette carte une Adresse IP dans un nouveau réseau ou sous réseau !
L'OS/400 pourra toujours contacter la partition Linux, mais vos autres postes
?
Vous avez quatre solutions : Les 3 premières impliquent CHGTCPA IPDTGFWD(*YES)
1/ Proxy ARP (sans doute la solution la plus simple avant la V7)
Attribuez au réseau inter-partitions (sur les cartes virtuelles) un sous
réseau de votre réseau LAN
- par exemple, vous êtes en 10.0.0.0/255.0.0.0 ==> utilisez 10.4.0.0/255.255.0.0
- autre exemple vous avez comme réseau 255.255.255.0 ==> utilisez
les adresses de 25 à 30 avec 255.255.255.248
Ensuite créez l'interface comme ceci :
ADDTCPIFC INTNETADR(‘10.4.1.1’) LIND(VETH1) SUBNETMASK(‘255.255.0.0’)
LCLIFC('10.3.1.1')
où 10.3.1.1 est l'interface de la carte physique.
2/ nouveau réseau : par exemple 172.16.1.1 coté OS/400, 172.16.1.2 coté Linux
(imaginons l'adresse IP de la carte physique comme
étant 10.3.1.1)
l'AS/400 est votre passerelle par défaut ou vous pouvez modifier les
routes sur vos postes afin d'indiquer l'adresse IP de votre AS (10.x.x.x)
comme route pour le réseau 172.16.0.0 (route add ... sous Windows)
3/ la troisième est d'utiliser NAT.
4/ enfin, la solution arrivée avec la V7 de IBM i , Bridging
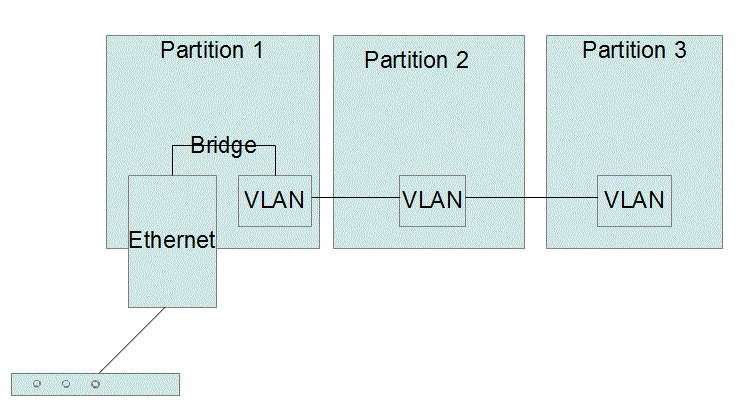
faites une ligne sur la carte Ethernet réelle, si possible sur un port dédié, sans adressage IP (plus simple avec les cartes 4 ports)
CRTLINETH LIND(ETHBRIDGE) RSRCNAME(cmnxx) BRIDGE(passerelle)
via la HMC, puis faites une carte Ethernet virtuelle en activant la fonction de passerelle
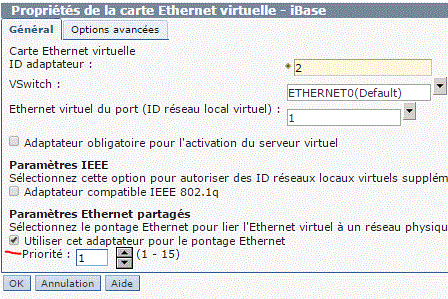
créez alors une deuxième ligne :
CRTLINETH LIND(VETHBRIDGE) RSRCNAME(cmnyy) BRIDGE(passerelle)
sur les partitions hostées, faites simplement une carte Ethernet "normale" sur les cartes virtuelles, le trafic IP sera routé vers l'extérieur
-> vérifiez bien que vous avez le même numéro de réseau (ID réseau local virtuel, 1 par défaut)
Créez ensuite votre espace de stockage par la commande
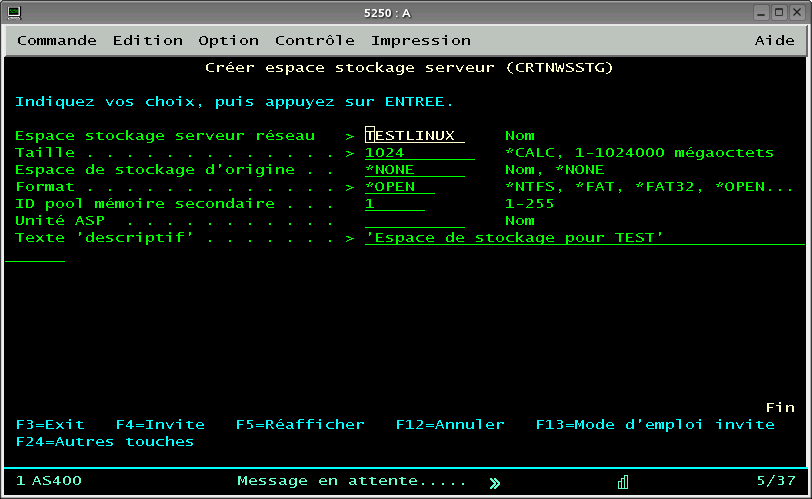
puis le serveur de réseau
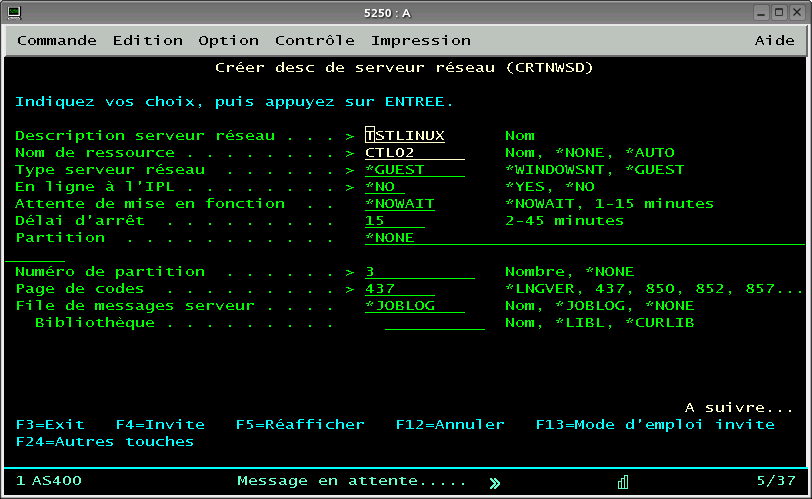
notez le contrôleur CTL02 et le N° de partition (on peut aussi utiliser
le nom)
la page de code doit être 437
ATTENTION au paramètre PWRCTL
- *NO, la mise en/hors fonction de la partition est gérée par
la console HMC
- *YES, la mise en/hors fonction de la partition est gérée
par le VRYCFG OS/400, qui envoi une demande de démarrage au FSP
- la partition de gestion de l'alimentation pour cette partition doit être la partition IBM i passant la commande VRYCFG
- le serveur SCSI doit être dédié à cette partition , on ne peut pas laisser "any partition can connect"
enfin, faites l'association entre les deux
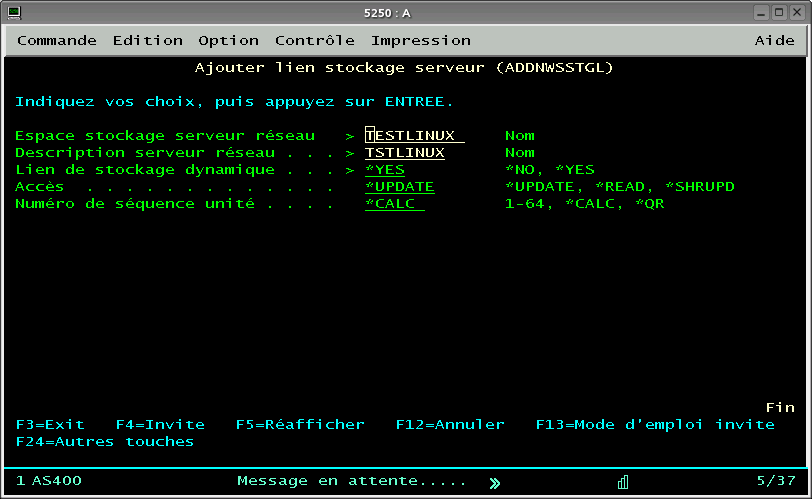
vous êtes bientôt prêt pour l'installation
de votre distribution
Si vous souhaitez une console Linux distante (sur votre PC, par exemple avec
puTTY plus "sympa" d'utilisation que le terminal sous HMC)
:
votre client Telnet se connectera au microcode
OS/400 qui servira de passerelle avec la partition Linux
(c'était la seule méthode en version précédente, sur
les modèles 270/8xx)
1/ Il nous faut ajouter un adaptateur virtuel à la partition I5/OS afin de définir
le client console virtuelle.
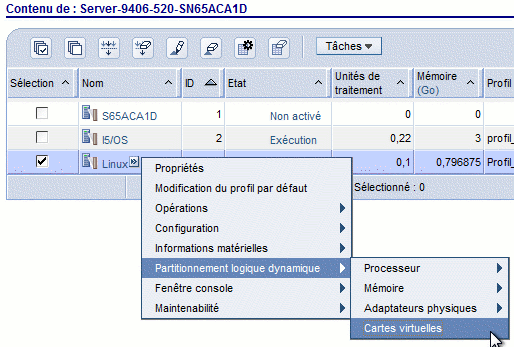
indiquez
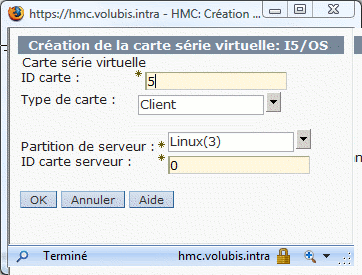
- a/ un id carte unique pour la partition I5/OS
- b/ le type client
- c/ le nom de la partition Linux
- d/ l'id carte serveur 0 (console)
2/ Sous SST, créez un profil SST auquel vous donnez les droits de gestion
de la partition linux
(comme pour une installation linux AS400
[V5R20] )
3/ Ensuite, lancez un client telnet (si vous avez un poste linux c'est parfait,
sinon voyez puTTY sous Windows)
- telnet as400 2301 ( console virtuelle sur le port 2301 et
non 23)
- choisissez votre partition et signez vous avec le profil SST que vous avez
créé.
- sur un session 5250, activez le serveur de réseau (WRKCFGSTS)
- retournez sur la session telnet et suivez les instructions ...
Autre possibilité sur une HMC V7
1/ lancez une session SSH avec puTTY sur la HMC
2/ loggez vous et tapez vtmenu
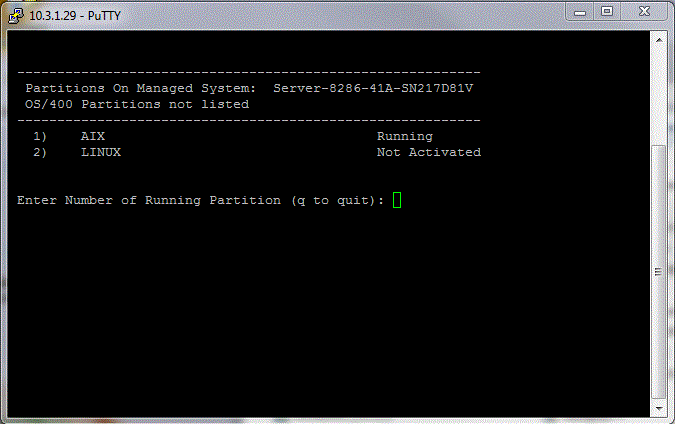
- Insérez le CD de la distribution et passez la commande
suivante :
- CHGNWSD IPLSRC(*STMF)
IPLPARM(vnc=1) pour une Suse
(voyez le contenu de votre CD qui
peut changer suivant la version )
- CHGNWSD IPLSRC(*STMF)
IPLPARM(vnc) pour une RedHat
Si vous ne renseignez pas IPLPARM, l'installation se fera en mode caractère
dans la fenêtre terminal, sinon vous profiterez de l'interface graphique
du client VNC
(qu'il faut avoir installé sur un poste à coté).
Si vous renseignez le paramètre vnc_password
, pensez à ce que le mot de passe soit conforme aux règles imposées
par la distribution
(par exemple SUSE impose un mot de passe ayant une longueur comprise entre 6
et 8 caractères)
- Démarrez ensuite la partition avec ouverture d'une fenêtre terminal en MODE
SMS
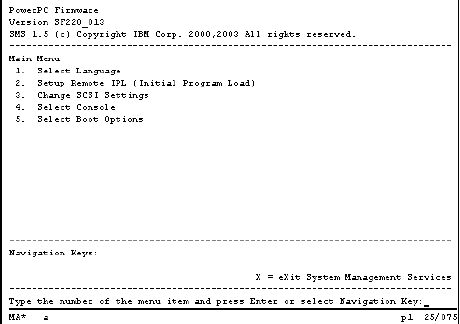
choisissez les options de Boot, lecteur de CD/ROM de type SCSI.
- Sur un session 5250, activez le serveur de réseau avec WRKCFGSTS
*NWS et mettez le Vary On,
- puis suivez les instructions dans la fenêtre de terminal.
La partition démarre et vous devez suivre les instructions à l'écran
si vous utilisez VNC, il faut d'abord configurer le réseau, le programme d'installation vous demande
ensuite, SUSE lance un produit d'installation nommé YAST (ou YAST2), REDHAT Anaconda.
le système linux va considérer votre espace de stockage (objet *NWSSTG)
comme son premier disque dur SCSI(sda), sur lequel il va créer trois partitions.
sda1 partition primaire, dite de boot.
sda2 partition de swap
sda3 partition linux native pour / (root)
ensuite, vous devrez configurer le réseau, particulièrement "IBM virtual ethernet"
auquel vous associerez l'adresse IP 10.4.1.2 (dans nos exemples)
Puis installez les produits (packages), suivants vos choix.
Quand c'est terminé, arrêtez linux (halt), mettez la partition hors fonction.
Enfin modifier la description coté I5/OS, afin qu'elle boot depuis le "disque dur"
par CHGNWSD NWSD(LINUX) IPLSRC(*NWSSTG) IPLPARM(*NONE)
|
C'est toujours un peu plus
simple si vous avez déja installé cette distribution (version
classique) sur un PC à base Intel.
Pour plus de détails voyez le
redbook SG246388.pdf et le cours suivant (Volubis) sur l'administration
linux dans une partition
Si vos PC sont sous Windows, deux outils vous seront très utiles,
particulièrement si votre serveur fonctionne en mode caractères
:
- WinSCP pour faire des transferts de fichier en utilisant SCP (serveur
sécurisé et déja configuré, pas de serveur FTP
à monter)
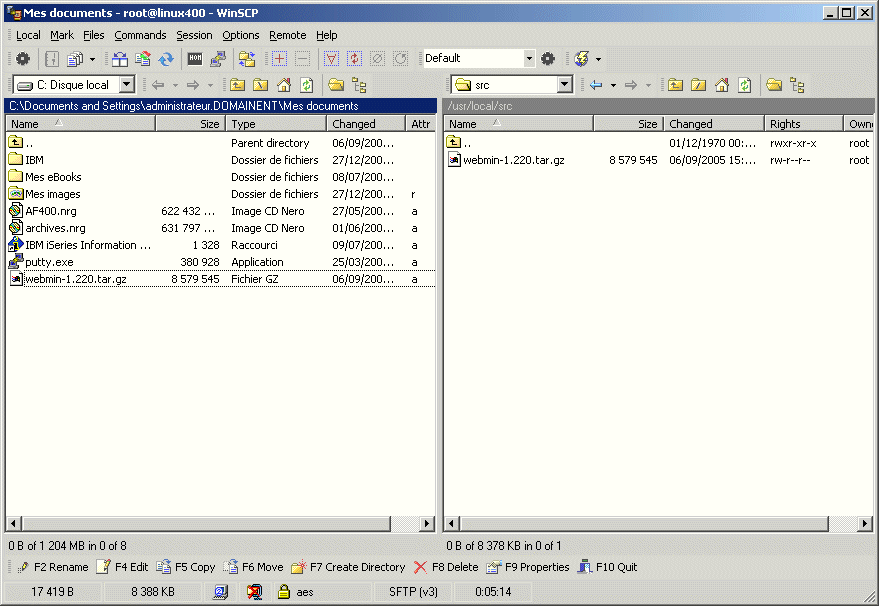
- PuTTY, l'émulateur de terminal sous Windows
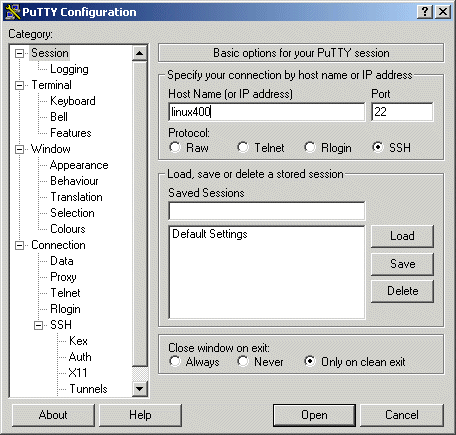
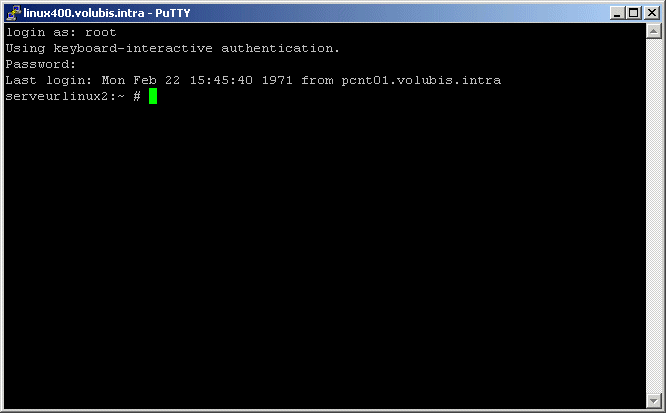
vous pouvez alors passer des commandes (vous pouviez aussi ouvrir un terminal
sur la console HMC).
rappels des principales
commandes :
- Exit pour quitter le shell (donc
la fenêtre de terminal)
- whoami : voir le nom de connexion
(le profil) actuel
- uname ; voir des informations sur le système (-a
affiche tout)
- pwd : voir le nom de la directory
en cours
- ls : voir le contenu de la directory
en cours
- more fichier, ou utilisé
avec un | (prononcer pipe
en anglais) affiche le texte écran par écran (entrée
pour avancer)
- less (c'est un jeu de mots) fonctionne comme more, mais la navigation
est plus simple (pageup/pagedown, q pour sortir)
- cat affiche le contenu d'un fichier
cat fichier | more affiche le fichier écran
par écran
- free et
vmstat affichent des informations sur la mémoire
- ps : voir les processus.
- ps -T montre les processus lancés depuis le terminal
- ps -A montre tous les processus
- ps --forest pour montrer la parenté des processus.
- top : affiche des informations globales
sur les processus actifs (un peu comme WRKACTJOB)
- le nombre de tâches
- la cpu utilisée
- la mémoire disponible
- la liste des tâches actives, classée par CPU consommée
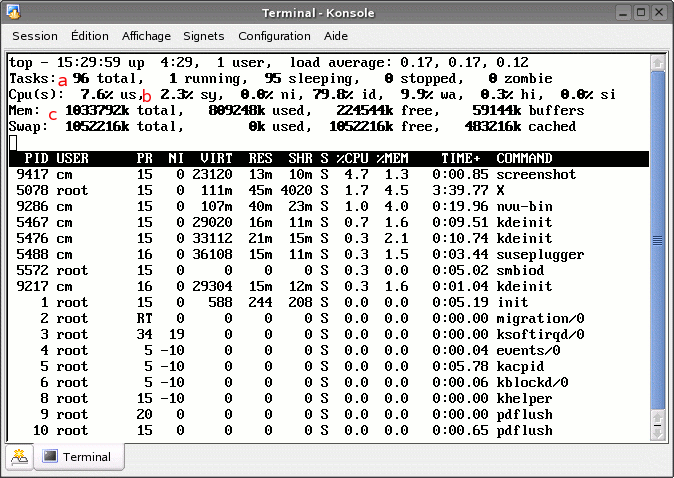
- kill pour tuer un processus, sur
son n°(saisir k sous top)
-s permet de précisier le type de signal envoyé au processus
:
- SIGSTOP : demande d'arrêt
- SIGTERM : demande de fin de process (signal par défaut envoyé
par KILL)
- SIGKILL : demande de fin forcée (un process ne peut pas ignorer
SIGKILL)
- info cmd : donne des informations
sur cmd
- man cmd : voir le manuel sur la commande cmd
(par exemple man ps), plus complet que info
- which cmd (par
exemple which xclock) vous indique où se trouve la commande
cmd
- cmd & : exécute cmd
en tâche de fond (par exemple
xclock &) et vous fournit le n° de process
(relancez ps -T pour le vérifier)
- nice -n xx cmd
lance cmd avec une priorité relative de xx (par exemple nice
-n 10, lance le process avec une priorité inférieure de 10)
- renice change la priorité d'un processus actif.
- bg passe un processus en arrière
plan (background) fg le repasse en avant plan.
- su : pour devenir root
- adduser ou useradd
: pour créer un nouvel utilisateur (vous devez être root)
- passwd user pour modifier le mot de passe de user
- Dans tous les cas, le serveur webmin sera un plus
allez chercher les sources sur le site http://www.webmin.net
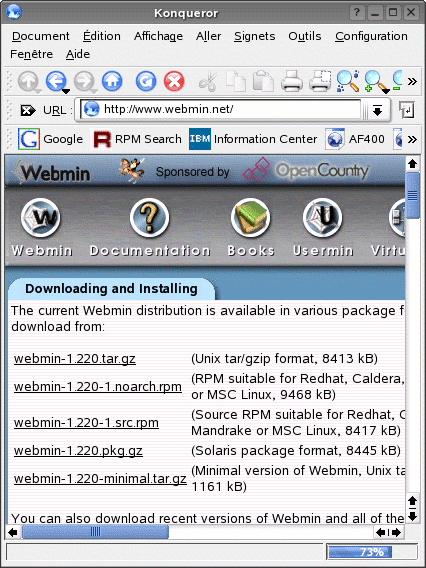
choisissez le fichier webmin-1.xxx.tar.gz (ici, la version 1.220)
placez ensuite (avec winSCP ou FTP) ce fichier sur votre serveur Linux, dans
/usr/local/src
et sous PuTTY, tapez (si votre version est la 1.220) :
cd /usr/local/src
tar
-xvf webmin-1.220.tar.gz (cette commande "dézippe"
le fichier)
cd
webmin-1.220
./setup.sh
|
- répondez par défaut à toutes les questions
- saisissez un mot de passe pour admin, quand demandé
- tapez y
aux deux questions :
- use ssl ?
- start webmin at boot ?
Vous pouvez aussi télécharger le RPM et taper :
rpm -ivh webmin-1.220-1.noarch.rpm (ou qqchose comme ca, suivant la version)
et voilà, le service est disponible à l'url : http://linux400:10000
ou https://linux400:10000
signez vous
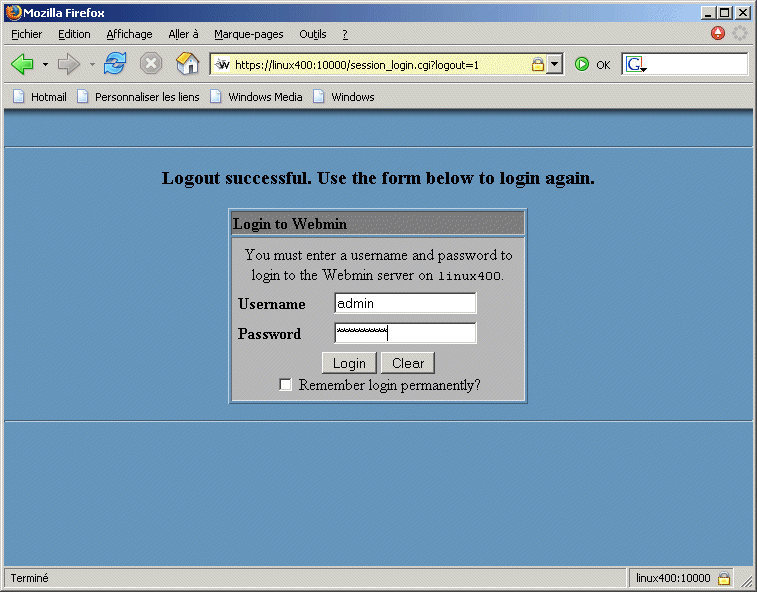
voilà !
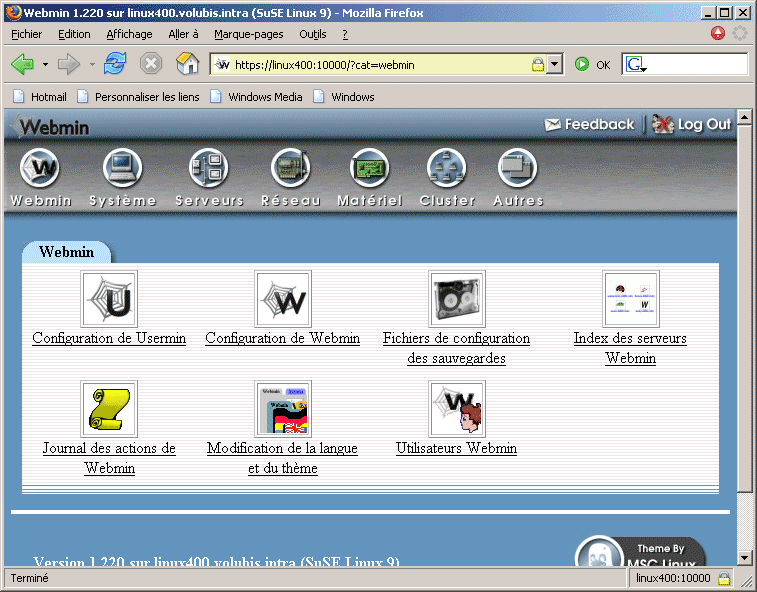
Copyright © 1995,2007 VOLUBIS